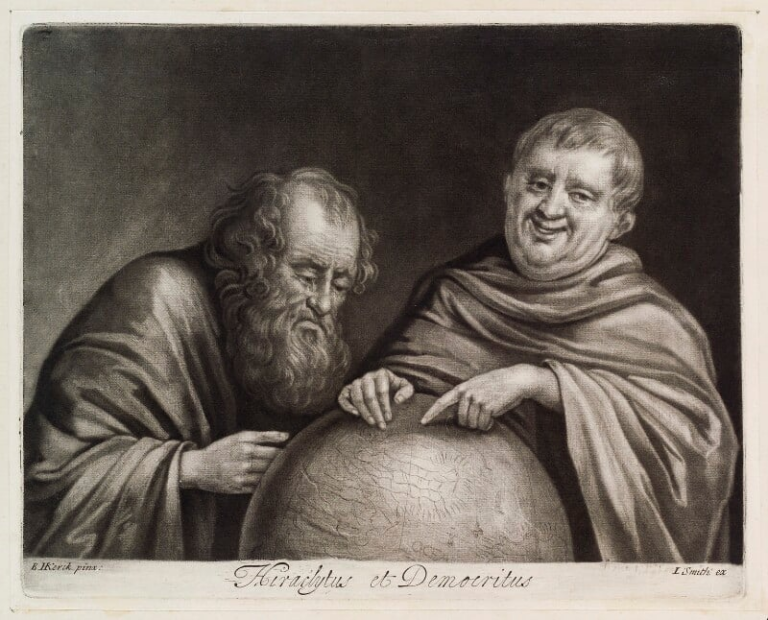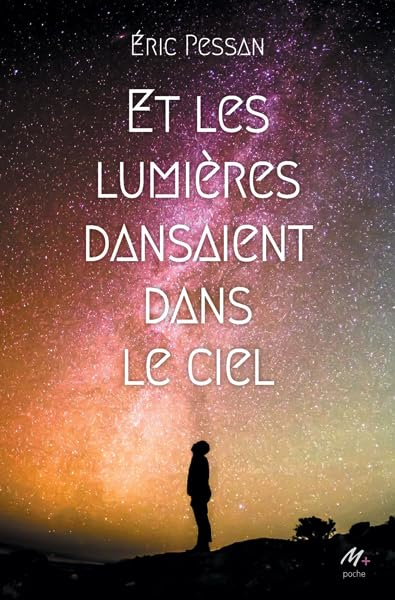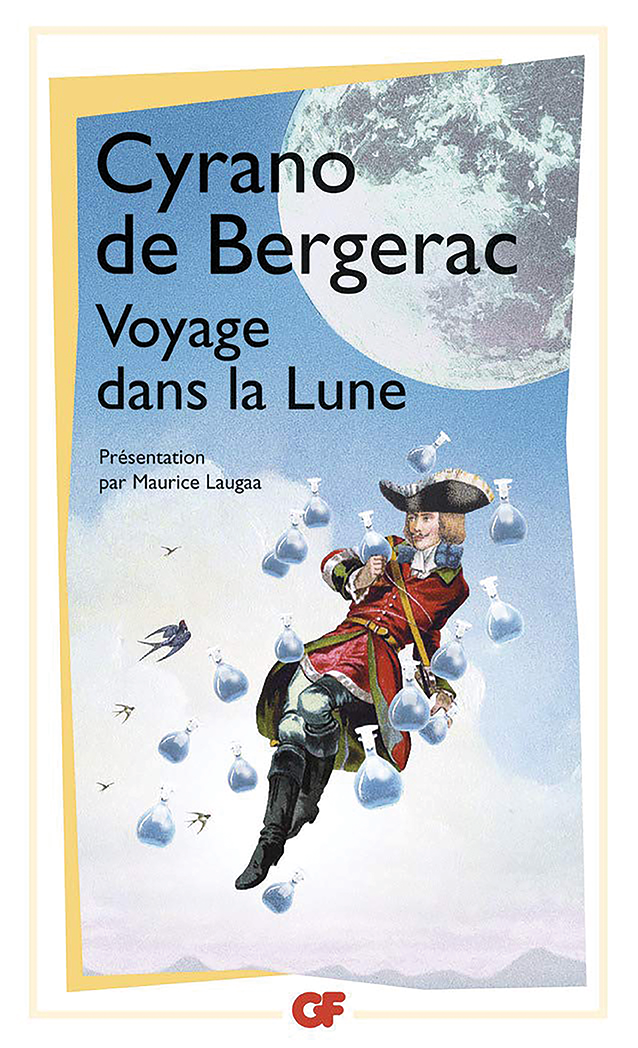Le Menteur, de Pierre Corneille :
études de textes
Acte II, scène 5 : le mariage forcé ; acte IV, scène 5 : la fausse grossesse ; acte V, scène 3 : la vérité
et le mensonge réconciliés. La pièce de Corneille, au programme des premières générales et
technologiques, fait du mensonge le point pivot entre la comédie et la tragédie. Et il faut comprendre mensonge comme travestissement, ce qui le rapproche du rôle du comédien.
Par Pascal Caglar, professeur de lettres (académie de Paris)
Par Pascal Caglar, professeur de lettres (académie de Paris)