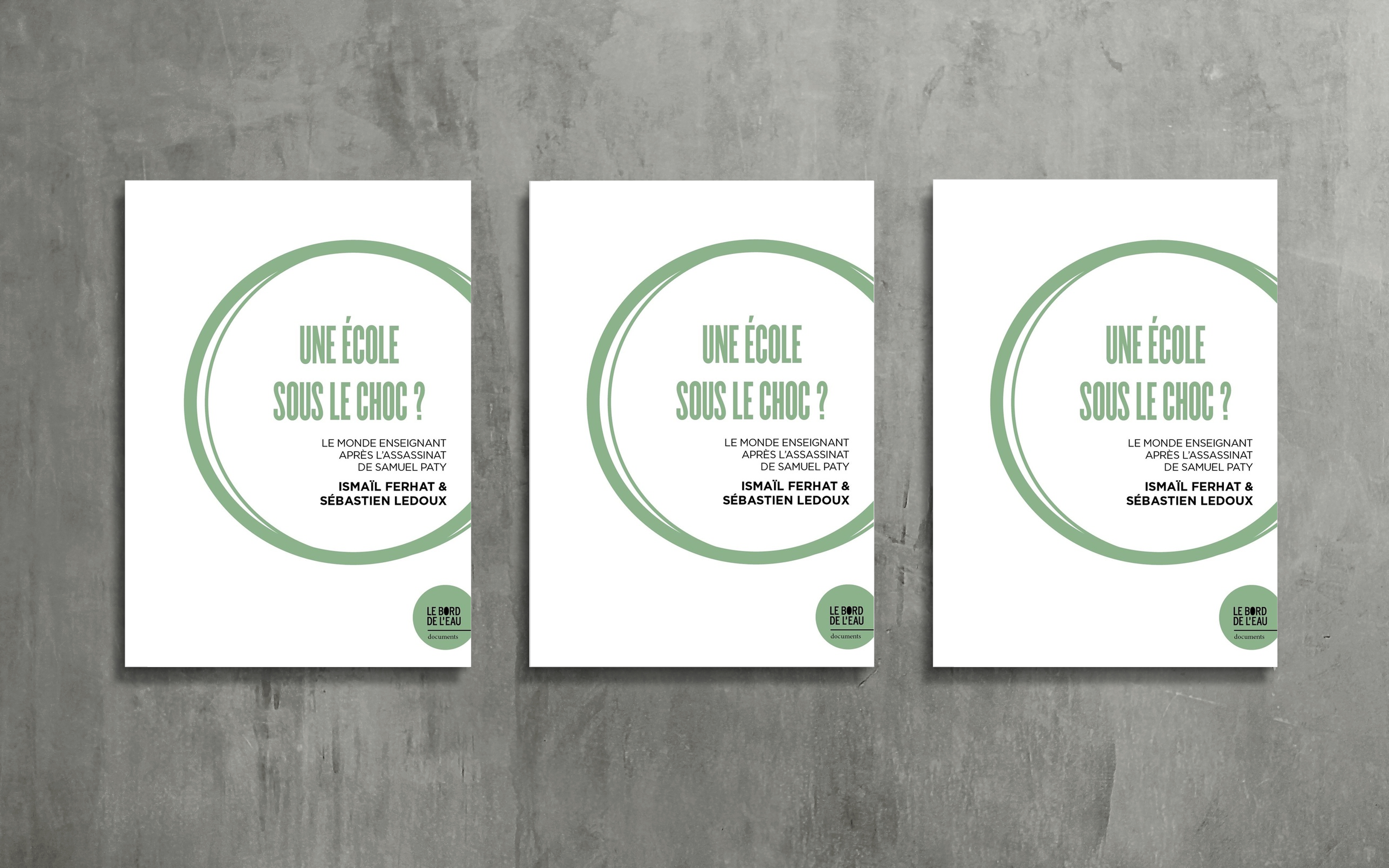
Une école sous le choc ?
d’Ismaïl Ferhat et Sébastien Ledoux :
enquête sur l’intranquillité
L’assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, a traumatisé le milieu scolaire. Professeur en sciences de l’éducation et historien, Ismaïl Ferhat et Sébastien Ledoux ont conduit une enquête qualitative auprès d’enseignants et de personnels éducatifs pour mesurer les conséquences du drame.
Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres, Inspé Paris Sorbonne-Université
L’assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, a traumatisé le milieu scolaire. Professeur en sciences de l’éducation et historien, Ismaïl Ferhat et Sébastien Ledoux ont conduit une enquête qualitative auprès d’enseignants et de personnels éducatifs pour mesurer les conséquences du drame.
Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres,
Inspé Paris Sorbonne-Université
Les deux auteurs sont membres du jury du prix Samuel-Paty1 porté par l’Association des professeurs d’histoire et géographie (APHG). Aujourd’hui universitaires, professeur en sciences de l’éducation pour Ismaïl Ferhat et historien pour Sébastien Ledoux, ils rappellent d’emblée qu’ils sont eux-mêmes d’anciens professeurs d’histoire-géographie. La synthèse de leur recherche (90 pages) s’appuie d’une part sur une enquête qualitative nourrie par 34 entretiens réalisés en 2020 et 2021, « auprès d’élèves, d’enseignants et de personnels éducatifs d’une grande agglomération urbaine ». Elle intègre d’autre part 985 réponses à un questionnaire posté en ligne. À ce premier travail de dépouillement s’ajoute celui de la presse nationale et locale et de 15 discours de responsables politiques, allant du 16 octobre 2020 au 31 décembre 2023.
L’ouvrage se distingue par une attention scrupuleuse portée à tous ces documents contenant des réactions et retraçant l’historicité de différents drames frappant le corps enseignant. La première partie s’intéresse à l’avant 16 octobre, et retrace « les grandes évolutions en matière de conflits entre phénomènes religieux et système éducatif ». Dans la seconde partie du livre, il s’agit d’analyser selon une approche lexicographique les réactions des enseignants au « choc » . La troisième partie s’intéresse plus spécifiquement au décalage entre prescriptions institutionnelles et pédagogisation de l’attentat contre Samuel Paty.
Les prémices du « choc »
Les tensions entre instruction et religion se développent sensiblement en France à la fin du XIXe siècle. Cependant, comme le soulignent les auteurs, elles « changent de nature » à partir des années 1980, « avec l’irruption de l’islam dans les controverses scolaires ». L’ouvrage souligne par ailleurs opportunément dans les mêmes années « l’investissement inédit, par l’Éducation nationale, des thématiques liés à la République ». Cette valorisation de l’éducation civique, dans le cadre duquel le cours incriminé de Samuel Paty s’intégrait, est d’autant plus significative qu’elle s’affermit au moment de « l’affaire des foulards », soit à partir de 1985. Il apparaît ainsi essentiel aux auteurs de montrer que l’avant « Samuel Paty » correspond à plus de 30 ans où le sujet de l’islam en France, « et par ricochet, du cadre laïc et républicain », s’aiguise et se médiatise. Sur cette période, historiquement riche, comprenant notamment la seconde Intifada en 2000, un ouvrage fait date, Les Territoires perdus de la République (2002) qui s’appuie sur des témoignages d’enseignants. Dans la société française, l’équation, grands ensembles urbains = islam radical = contestation de valeurs républicaines, devient alors quasi définitive, a fortiori après les émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005. Toutefois, les auteurs insistent surtout sur le véritable premier « choc » correspondant aux attentats de 2015 contre l’équipe de Charlie Hebdo. En effet, pour la première fois d’une façon aussi paroxystique, nombre d’enseignants se retrouvent « désemparés » par une cruelle « dissociation entre culture religieuse et symbolique républicaine » chez leurs élèves. Sujet désormais médiatisé à outrance, comme précisé par les deux universitaires, la montée de l’intégrisme musulman est exacerbée au moins autant que la « faillite de l’école républicaine ». Dans ce contexte, il est rappelé que le ministère de l’Éducation nationale se trouve sous le feu des projecteurs. Ce qui le conduit au fil du temps à des initiatives aussi graduelles que significatives telle que la création au sein du ministère d’un « service de défense et de sécurité » dédié aux « faits d’établissement ».
Les modes de réaction au « choc »
Le terme « choc » s’impose, dans le cas de l’assassinat de Samuel Paty, par le fait que la profession en est affectée de façon homogène même si l’émotion demeure encore plus marquée chez les enseignants d’histoire-géographie et de lettres-histoire-géographie. Dans les « écrits dépouillés » dont l’essai rend compte, certains mots reviennent comme « seul » ou « solitude ».
Toutefois, à l’inverse du discours politique prompt à soulever des « notions générales » comme « liberté d’expression », les mots des enseignants se répartissent entre l’expression d’un ressenti (« peur », « sidération », « colère ») et la préfiguration d’une pédagogisation de l’attentat (« concertation », « protocole », « échange »). La réaction individuelle, voire intime, tend à se corréler à un besoin d’action, impliquant du « collectif ».
C’est d’ailleurs ici que le propos des auteurs devient le plus instructif par sa capacité à briser certaines idées reçues sur un monde enseignant complètement fragmenté, alors que les réactions post-attentat confirment qu’il possède encore « les caractéristiques propres d’un corps professionnel ». De fait, c’est essentiellement en interne (entre enseignants) que s’est effectuée « la prise en charge scolaire de la tragédie », et cet au-delà de la minute de silence imposée par le biais de « séquences pédagogiques » et de « discussions en classe ».
L’étude de cette dimension pédagogique permet d’observer un décalage entre les prescriptions du ministère de l’Éducation nationale, qui, « depuis les attentats de janvier 2015, tend à mettre l’accent sur la laïcité à chaque “choc” rencontré par le système scolaire » et les actions concrètes des enseignants qui impliquent majoritairement une verbalisation de « ce qui s’est passé ». D’après Ismaïl Ferhat et Sébastien Ledoux, « Ce positionnement professionnel marque une continuité avec celui observé pour janvier 2015 : les enseignants avaient souvent répondu à l’attentat par d’autres contenus que la laïcité ».
Des témoignages comme pièce à conviction
Le troisième chapitre de l’ouvrage permet de prendre la mesure du fracas causé par l’assassinat de Samuel Paty non seulement dans le monde enseignant, mais dans chaque conscience enseignante. Les témoignages transcrits – « Là, je me dis, ouais, on est vraiment attaqué au cœur de notre métier, quoi » – soulignent qu’à un moment ou à un autre, chaque enseignant s’est imaginé en Samuel Paty.
L’étude des « entretiens » illustre aussi combien les enseignants ont déploré le manque de soutien de leur hiérarchie. Or, comme le rappellent les auteurs, « les années précédant [l’assassinat] sont marquées par le mot-clé «#Pasdevagues » sur les réseaux sociaux ». Ainsi, beaucoup d’enseignants ont été choqués par le manque d’accompagnement de la minute de silence programmée le 2 novembre (après les vacances de Toussaint). Le refus du « bricolage » est alors allé de pair avec l’impression d’un décalage entre la « demande institutionnelle » – lecture de la lettre de Jean Jaurès » – et la nécessité d’une action concrète à mener avec les élèves.
« Je me retrouve avec cette lettre dans les mains et je me retrouve à tout lire. Et je vois que ça dure 5-10 minutes. Ça se passe bien mais en lisant cette lettre, il y a la colère qui revient par rapport au fait que ce soit complètement déconnecté de la réalité ».
Les entretiens dépouillés mettent en perspective l’intensité émotionnelle des discussions en classe à la rentrée de novembre 2020. Il y a bien un après Samuel Paty, mais pas nécessairement comme on pouvait l’envisager. En effet, ce n’est pas uniquement l’assassinat en lui-même qui retient l’attention des élèves mais des thèmes inattendus en pareil contexte comme « la persécution des musulmans ». Il n’en reste pas moins, comme le synthétisent les auteurs, que « la mise en débat comme son cadrage dans une relation de confiance enseignant-élèves se sont révélés essentiels dans la pédagogisation de l’attentat ».
L’ouvrage se conclut sur l’expression d’un paradoxe : alors que l’onde de choc du 16 octobre a donné lieu à une réaction homogène, chacun se sentant attaqué au cœur même de sa profession, le « bouleversement émotionnel n’a pas pu se transformer en socialisation collective ». Autrement dit, le sentiment d’isolement professionnel et personnel des enseignants n’a jamais été aussi fort voire délétère. En ce sens, beaucoup d’enseignants continuent de vivre douloureusement une mission de défense des valeurs républicaines qui ne sont pas en accord avec une régulation des inégalités sociales.
La lecture de l’ouvrage d’Ismaïl Ferhat et Sébastien Ledoux n’en apparaît que plus propice à un questionnement lucide sur un système éducatif français qui peine à s’humaniser en dépit de déclarations de principes consécutives à chaque choc.
A. S.
Une école sous le choc ? Le monde enseignant après l’assassinat de Samuel Paty, Éditions le bord de l’eau, 2024.
Notes
L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.
