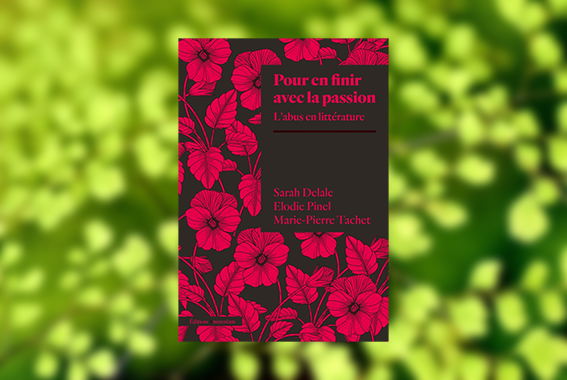
Pour en finir avec la passion.
L’abus en littérature, de Sarah Delale,
Élodie Pinel, Marie-Pierre Tachet :
renouveler l’œil critique
Dans des textes patrimoniaux, les personnages féminins sont victimes de violence que le lecteur est invité à fantasmer sous couvert d’esthétique. Trois chercheuses les analysent pour redéfinir l’amour et la passion avec d’autres critères et ainsi détoxifier la littérature et la lecture.
Par Milly La Delfa, professeure de lettres (académie de Paris)
En 2014 paraît aux États-Unis l’essai de Leslie Jamison, The Empathy Exams : Essays[1]. L’écrivaine y présente une série d’expériences lui permettant d’interroger le rapport que l’on peut avoir à la douleur de l’autre. Actrice médicale auprès d’étudiants en médecine qui doivent, à partir des faux symptômes qu’elle énumère, poser un diagnostic, elle se confronte – et le lecteur avec elle – à la possibilité de comprendre de façon intime la souffrance, les violences et les agressions que subissent les autres et en particulier les femmes.
La perception que l’on peut avoir d’une situation dépend donc de la place que l’on occupe. Pour la réévaluer, il faut oser faire un pas de côté et ne pas craindre de s’exercer à l’empathie, même à l’égard des êtres de fiction qui peuplent notre littérature patrimoniale. C’est ce décalage, à la fois infime et essentiel, que Sarah Delale, Élodie Pinel et Marie-Pierre Tachet mettent en œuvre dans Pour en finir avec la passion. L’abus en littérature. Un essai paru aux éditions Amsterdam en 2023, dans lequel ces trois chercheuses françaises – respectivement agrégée de lettres et docteure en littérature, agrégée de lettres et de philosophie et chercheuse en littérature, et diplômée en philosophie et en sciences de l’éducation travaillant dans les ressources humaines – proposent une analyse féministe de la littérature. Elles invitent notamment à réfléchir sur l’évolution des conceptions culturelles et littéraires en relisant des chefs-d’œuvre avec l’œil d’aujourd’hui. Celui-ci met principalement en cause le lien quasi patrimonial entre passion et souffrance des femmes.
Sarah Delale, Élodie Pinel et Marie-Pierre Tachet tiennent à présenter « des visites alternatives (…) en s’appuyant sur un système moral explicite et situé[2]»des textes littéraires. Il s’agit de proposer une nouvelle façon de lire certains ouvrages en indiquant d’emblée la « situation » de celui ou celle qui analyse, en l’occurrence trois universitaires féministes nées dans les années 1980 et vivant en Europe de l’Ouest. Elles adoptent une posture critique cherchant « à garantir et renforcer la dignité humaine de tous les individus[3] », c’est « le système moral » qui sert de grille de lecture à leur étude. Leur objectif dans cet essai est de montrer que, sous couvert de « passion », des personnages féminins de la littérature sont victimes de violences inacceptables et invisibilisées.
Cette attention à expliciter le point de vue à partir duquel est émis un discours critique est héritée des travaux de la biologiste et philosophe féministe Donna Haraway et de la penseuse Sandra Harding. Ces chercheuses contestent une prétendue objectivité scientifique et insistent sur la nécessité d’établir le positionnement de celui ou celle qui construit une analyse afin de pouvoir prendre en compte les conditions matérielles de production de cette pensée.
Se situant dans cette lignée critique, les autrices de Pour en finir avec la passion. L’abus en littérature disent clairement s’attacher au « contenu des œuvres littéraires[4] » plus que ne le font les « approches esthétisantes » pour présenter des interprétations originales de textes ayant déjà fait l’objet de nombreuses études.
Ce que « passion » veut dire
L’essai s’ouvre sur la nécessité de redéfinir l’amour et la passion, ou du moins la vision que la littérature et les discours paralittéraires en ont donné. Alors que l’amour est un sentiment duquel peut naître une union consentie et sans danger pour les partenaires, la littérature l’a dévalorisé au profit de l’intensité brûlante de la passion. Que ce soit dans le roman Les Hauts de Hurle-Vent, d’Emily Brontë, ou dans le récit d’autofiction Passion simple, d’Annie Ernaux, le fait de parler de la passion comme « de la forme la plus vraie, la plus parfaite de l’amour est donc littéralement un abus de langage[5] », puisque, dans ces œuvres, la passion n’a plus le caractère inoffensif de l’amour mais au contraire devient un attachement menaçant. Les chercheuses rappellent comment, au cours de l’histoire critique des œuvres littéraires, le primat de la forme, celui du signifiant sur le signifié, s’est constitué comme argument réfutatoire incontestable à toute tentative de questionnement moral de la fiction.
Protégé par sa dimension esthétique, le livre patrimonial peut faire étalage de comportements abusifs sans être inquiété. Les écrivaines dénoncent ce recours à « une suspension de la morale en littérature[6] », sous prétexte que ce qui est écrit n’a pas de dessein éthique mais une visée esthétique. Leur récapitulatif des œuvres au programme de l’épreuve anticipée de français entre 2019 et 2022 fait froid dans le dos. Pour la série générale, la lecture intégrale d’un roman offrait trois possibilités :
« Le premier évoquait une relation pédophile entraînant la mort de l’enfant concerné (Les Mémoires d’Hadrien), le deuxième était entièrement structuré autour d’un harcèlement sentimental et sexuel (La princesse de Clèves) et le troisième se terminait sur une tentative de féminicide cynique et assumée (Le Rouge et le Noir)[7]. »
Ne pas être dupe des stratégies d’atténuation
Sarah Delale, Élodie Pinel et Marie-Pierre Tachet accordent une attention particulière à une figure de style qui participe à ce système d’abus en littérature : l’euphémisme.
Dans son usage microstructural, l’euphémisme permet de ne pas désigner dans son expression la plus directe, une réalité choquante. On parlera d’un viol comme d’une « contrainte », d’un harcèlement comme d’un « jeu de séduction ».
Dans son extension macrostructurale, il devient un élément non négligeable du mécanisme de silenciation des violences faites aux femmes. Ainsi, dans le chapitre consacré à Bel-Ami, intitulé « Bel-Ami ou la culture du viol[8] », les chercheuses invitent à relire l’épisode où le personnage de Georges Duroy raccompagne pour la première fois Clotilde de Marelle. Alors que celle-ci est ivre, il calcule le moment le plus propice pour lui sauter dessus :
« Elle avait fait un mouvement, un mouvement sec, nerveux, d’impatience ou d’appel peut-être. Ce geste (…) lui fit courir un grand frisson sur la peau, et se tournant vivement, il se jeta sur elle, cherchant la bouche avec ses lèvres et la chair nue avec ses mains[9]. »
À aucun moment, la narration n’engage à considérer cette scène comme une agression sexuelle car, et c’est là le tour de force du roman, « le narrateur se coule dans le regard masculin, il l’adopte sans recul[10]. » En s’écrivant à travers la vision subjective que le personnage a de ses relations avec les femmes, le roman véhicule une compréhension atténuée des abus dont Bel-Ami se rend coupable. De plus, son physique avantageux et sa réussite sociale l’éloignent de la vision traditionnelle qu’on se fait d’un agresseur sexuel. Ainsi « Dans la culture du viol, Georges Duroy ne peut être un violeur. Dans la plupart des lectures qui sont faites de Bel-Ami, non plus[11]. »
Cette stratégie d’atténuation contamine notre façon de lire les œuvres selon les trois chercheuses. En faisant passer des actes violents pour les manifestations d’un attachement passionnel, certaines analyses désamorcent notre capacité à en reconnaître le caractère répréhensible. Les mots sont là, la violence est explicite mais le lecteur n’est plus à même de l’identifier. Il ne sait plus lire ce qui est écrit noir sur blanc. Les autrices soulignent que :
« La conduite implicite de l’euphémisme encourage et pérennise les biais cognitifs […] Ces biais sont des facteurs déterminants dans l’évaluation subjective des risques que nous encourons dans la vie. En encourageant les lectures euphémistiques, on encourage une euphémisation des risques auxquels les personnages s’exposent et des abus qu’ils subissent, et on conduit le public à s’exposer dans le réel aux mêmes risques, sans même les percevoir comme risques [12]. »
Une voie nouvelle, des outils issus de différentes disciplines
Les chercheuses appellent à une conscience accrue du pouvoir pédagogique de la littérature et de l’incidence qu’ont les fictions sur notre perception du monde réel.
Elles font état des deux réactions de défense devant la « violence symbolique » que les œuvres littéraires sont susceptibles d’exercer sur le lecteur : la cancel culture et le « traumavertissement » – trigger warning – autrement dit un avertissement au public. Il s’agit, pour l’une, d’une stratégie d’évitement qui consiste à refuser de lire certaines œuvres qui portent atteinte à la dignité d’une partie de l’humanité ; et pour l’autre, d’une tentative de prévention.
Les chercheuses évoquent le cas de la série 13 Reasons Why. Cette série, diffusée Netflix et adaptée du roman éponyme, raconte l’histoire d’un jeune homme, Clay Jensen, qui reçoit des cassettes à travers lesquelles Hannah Baker, une camarade dont il était amoureux, explique les raisons de son suicide. Afin que l’esthétisation de la scène de suicide du dernier épisode ne soit pas considérée comme une incitation à se donner la mort, les producteurs ont introduit un « traumavertissement » en ouverture de la série[13].
À ces deux moyens de prévention à l’égard de contenus pouvant heurter les lecteurs (ou spectateurs), Sarah Delale, Élodie Pinel et Marie-Pierre Tachet ajoutent la possibilité d’une troisième voie qui permettrait de « lire de la fiction pour se protéger des pièges de la fiction et des dangers du réel[14] », une lecture qui jetterait la lumière sur les agissements problématiques de certains personnages et qui par là même permettrait d’ouvrir les yeux sur ces comportements dans la vie réelle.
Des outils issus de différentes disciplines
Les universitaires sollicitent l’usage d’outils appartenant au champ littéraire mais également à la sociologie et à la psychologie comme les exercices d’empathie dont il était question plus haut ou les dispositifs propres à la critique interventionniste dont Pierre Bayard est le fondateur.
La critique interventionniste prône une perméabilité entre le monde réel du lecteur et le monde fictionnel des personnages. Pour évaluer le risque ou la violence d’une situation pour le personnage, il faut que le lecteur se glisse dans le roman pour « mesurer quelles sont les alternatives de tous les personnages à chaque instant du récit, en fonction de leurs possibilités réelles et non d’une pleine liberté théorique[15] ».
Afin de défendre convenablement un personnage, par exemple la duchesse de Langeais[16] que Montriveau, son amant, incrimine : « Vous avez commis un crime. » sans lui laisser la moindre chance de répondre à cette accusation, les autrices prononcent une plaidoirie au terme de laquelle elles demandent la « relaxe totale » du personnage féminin mais également la recatégorisation du roman « Ne placez plus « La Duchesse de Langeais » parmi les histoires d’amour, placez-la parmi les histoires d’abus[17]. »
Œuvre littéraire ou cas clinique ?
« Ne sommes-nous pas en train de transformer une œuvre littéraire en cas clinique[18]? » Cette question que se posent les autrices lors d’une analyse des livres de Marguerite Duras, L’Amant et L’Amant de la Chine du Nord, est censée anticiper les réticences que l’on peut éprouver à la lecture de certaines interprétations. Le recours aux sciences humaines, pour décrypter la psychologie d’êtres qui ne sont finalement que des créatures de papier, n’est pas toujours convaincant et les exercices qui soutiennent les analyses, s’ils sont stimulants, affaiblissent parfois le propos théorique.
Le duc de Nemours est considéré par les chercheuses comme un homme harcelant, puisqu’il est incapable d’entendre le « non », réitéré de la princesse de Clèves, ni de prendre en compte ses tentatives d’éloignement. Afin de comprendre le profil de ce personnage masculin, les chercheuses ont recours à une classification conjointe de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et de l’AAP (Association américaine de psychiatrie). Celle-ci met en lumière six traits caractéristiques du trouble de la personnalité qui se retrouve chez une personne harcelante : l’affectivité négative, le détachement social, la dissocialité (une incapacité à l’empathie), la désinhibition, l’anankastie (un souci exacerbé de la norme) et l’état limite.Ces pures catégories psychiatriques vont servir de « grilles de lecture aux différents personnages de La Princesse de Clèves. » et permettent de conclure que le duc de Nemours possède « le profil (…) du harceleur triomphant ».Cet usage de catégories médicales suppose que l’on attribue au personnage une psyché indépendante des topoi littéraires qu’il incarne, et c’est lui accorder un libre arbitre qui outrepasse l’arbitraire romanesque.
Un champ d’analyse post-#metoo
Malgré cette dimension que d’aucuns jugeront anachronique voire peut-être abusive, cet essai vient rappeler que la littérature n’est pas un art détaché complètement détaché de son lectorat, qu’elle peut en prendre soin et l’accompagner dans le métier de vivre.
Dans cet essai, ce ne sont pas les livres qui sont incriminés mais les lectures critiques que l’on a pu en faire. L’essai, pour sa part, cherche à nous « défaire de nos habitudes de lecture[19] », celles qui poussentà confondre les histoires d’abus avec des histoires d’amour et maquillent en fausses romances de relations de domination[20].
Il n’est jamais question de ne plus lire certaines œuvres mais de les lire avec un œil averti. « Le but n’est pas de décerner des prix en dressant la liste des bons et des mauvais livres. Ce qui nous importe, c’est de distinguer les bonnes et les mauvaises lectures[21] », soulignent les autrices.
Tout comme une œuvre dépend de son contexte de création et de parution, une lecture critique est également le fruit de son époque. Or, le champ critique a besoin, grâce aux avancées sociétales en particulier dans le domaine de l’attention accordée aux femmes, de se renouveler. Il s’agit aussi pour les enseignants qui sont les passeurs de cette littérature patrimoniale, d’accompagner les jeunes lecteurs dans ces nouveaux positionnements critiques et de réfléchir avec eux sur ce que l’on peut dire de ces histoires à l’heure où la société est en train de prendre la mesure des violences qui sont faites aux femmes.
M. L.-D.
Sarah Delale, Élodie Pinel, Marie-Pierre Tachet, Pour en finir avec la passion. L’abus en littérature, Éditions Amsterdam, 2023.
Notes
- [1]Leslie Jamison, Examens d’empathie, trad. Philippe Aronson et Emmanuelle Aronson, Livre de Poche, 2018.
- [2]Sarah Delale, Élodie Pinel, Marie-Pierre Tachet, Pour en finir avec la passion. L’abus en littérature, Éditions Amsterdam, 2023, p. 26.
- [3] Op. cit.
- [4] Op. cit.
- [5] Sarah Delale, Élodie Pinel, Marie-Pierre Tachet, Pour en finir avec la passion. L’abus en littérature, Éditions Amsterdam, 2023, p. 15.
- [6] Ibid., p. 24.
- [7] Ibid., p. 25.
- [8] Ibid., p. 303.
- [9] Ibid., p. 309.
- [10] Ibid., p. 305.
- [11] Ibid., p. 324.
- [12] Ibid., p. 22.
- [13] « The following piece discusses a show that contains topics such as drug abuse, sexual assault and self-harm. »
- [14] Ibid., p. 26.
- [15] Ibid., p. 27.
- [16] Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais, 1834.
- [17] Ibid., p. 143.
- [18] Ibid., p. 346.
- [19] Ibid., p. 385.
- [20] On considéra comme exemples les dix œuvres auxquels sont consacrés les dix chapitres de l’essai.
- [21] Ibid., p. 386.
L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.
