Poète en temps de guerre. Leonard Cohen (1934-2016)
“Tout ce qui se déplace est blanc
une mouette, une vague, une voile,
et trop purement se déplace pour être singé.
Pourfends la souffrance.
Ne simule jamais la paix.”.Extrait de “Hydra 1960”, “Flowers for Hitler” (poèmes), 1966, Christian Bourgois éditeur, 1976.
Leonard Cohen est mort le jeudi 10 novembre 2016 – heure canadienne. La nouvelle nous est parvenue dans la nuit de notre 11-Novembre. L’homme, qui savait manier les symboles, s’avouait proche du trépas depuis quelque temps déjà et aurait apprécié sans doute qu’on apprît que le Commandant Cohen avait rendu les armes un jour d’armistice.
“Field Commander Cohen” est la chanson qui suit “Lover lover lover” dans l’album New Skin for the Old Ceremony de 1974. Quelques plages plus loin, juste avant “A Singer Must Die”, Cohen entonne “There is a war” : “C’est la guerre entre les riches et les pauvres, c’est la guerre entre l’homme et la femme. C’est la guerre entre ceux qui disent “c’est la guerre” et ceux qui disent “ce n’est pas la guerre”.”
Entre références religieuses et réflexions (souvent très crues) sur le sexe et le pouvoir, entre chansons d’amour et chansons de haine, nombre des compositions et poèmes de cet authentique Américain (j’ai bien écrit “Américain”, et non “États-Unien”), habité jusqu’à ses derniers jours par le thème de la rédemption, font référence directement à la guerre et au thème du conflit en général. “C’est la guerre / Vous êtes ici pour être détruits” (“This is war”, L’énergie des esclaves (poèmes), 1972, Christian Bourgois éditeur 1974). C’est que Leonard Cohen, que l’on taxa un peu rapidement de mélancoolique, comme s’il s’agissait d’une addiction, avait simplement perdu les illusions de la jeunesse lorsque son premier disque nous parvint au début de l’année 1968.
 Il avait connu déjà – et il en franchissait alors une nouvelle étape – un long parcours pour le moins compliqué. Compliqué par ses amours et ses croyances successives. Smash the pain. Humour cruel, fulgurances poétiques, lubies romanesques : tout en lui incitait à la curiosité, et tout en lui vous maintenait à distance. Chaos sentimental et zen, foi et dépression. Never pretend peace.
Il avait connu déjà – et il en franchissait alors une nouvelle étape – un long parcours pour le moins compliqué. Compliqué par ses amours et ses croyances successives. Smash the pain. Humour cruel, fulgurances poétiques, lubies romanesques : tout en lui incitait à la curiosité, et tout en lui vous maintenait à distance. Chaos sentimental et zen, foi et dépression. Never pretend peace.
On put le voir un temps discret fantôme dans les rues du XIVe arrondissement de Paris, plus tard moine bouddhiste près de Los Angeles, enfin quittant le devant de la scène pour y revenir bientôt : il eut une longue carrière, avec de longues éclipses, changea plusieurs fois de manière et de registre – on peut goûter modérément les sons synthétiques de nombre de ses productions à partir des années 1980… Et sa voix à force de s’enfoncer vint-cinq ans durant dans la profondeur des graves sembla creuser sa propre tombe.
Cette œuvre sombre pourtant ne balance pas seulement entre tristesse et colère, entre douleur de la rupture et sentiment de la perte : l’ironie la traverse de part en part, jusque dans sa vision sans concession de ce qu’il pensait en passe d’advenir aux États-Unis lorsqu’en 1992 il enregistre “Democracy” pour l’album The Future (avec ce refrain par antiphrase – ” Democracy is coming to the U.S.A.” – qui ne convainc pas même son auteur).
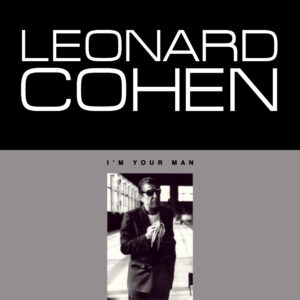 D’un ton presque détaché, Cohen examine avec lucidité le monde tel qu’il est :
D’un ton presque détaché, Cohen examine avec lucidité le monde tel qu’il est :
“Tout le monde sait que les dés sont pipés. Tout le monde sait que la guerre est finie, que tous les bons ont capitulé. Tout le monde sait qu’il n’y a pas de justice, les pauvres restent pauvres et les riches s’enrichissent. Les jeux sont faits, et tout le monde le sait.” (“Everybody Knows”, I’m your man, 1988, dans la traduction de Graeme Allwright).
“Smash the pain.
Never pretend peace.
Pain cannot compromise this light.”“Hydra 1960”, op.cit.
Ce dernier vers – “La souffrance ne peut compromettre cette lumière” – fait écho au refrain d’Anthem – qui, dans l’album The Future encore, à trente ans de distance, redonne espoir en un secours possible. “There is a crack in everything. / That’s how the light gets in.” (“Il y a une fêlure en toute chose / C’est par elle qu’ainsi entre la lumière“). Leonard Cohen crut-il pour autant qu’on puisse échapper à la noirceur générale, il est permis d’en douter à l’écoute de You Want It Darker, quatorzième et dernier album paru fin octobre. Le mystère reste entier qui régit les relations entre les hommes et les femmes – tout y est objet d’âpres négociations –, entre les êtres et les choses, et sans doute la sagesse consiste-t-elle à s’y résoudre.

Graeme Allwright, qui l’adapta pourtant si exactement, et le fit connaître ainsi au public français pour ce qu’il était – un poète, et non seulement un chanteur –, Graeme Allwright jamais ne chercha à abolir ce mystère.
C’est ce qui fait le prix des versions qu’il donna dans notre langue de “Suzanne”, de “Diamants dans la mine”, de “L’Étranger” et de quelques autres encore. Elles participent bien en effet du même esprit qui toujours présida à l’art de Leonard Cohen : s’il y a un sens à tout cela, c’est de produire de la beauté. Voilà donc pour ce qu’il nous lègue.
Il n’en reste pas moins vrai que les dernières paroles qu’il nous laisse entendre, pour clore son ultime album, loin de l’assurance d’un testament, sont tracées dans l’encre du regret et de l’inachevé :
“I wish there was a treaty
Between your love and mine.”
(“String Reprise / Treaty”)
C’est donc qu’il y a, jusqu’au bout, la guerre.
Robert Briatte
.
• Leonard Cohen, “String Reprise/Treaty”, 2016.
• Leonard Cohen, “Hey, that’s no way to say goodbye”, 1968.

