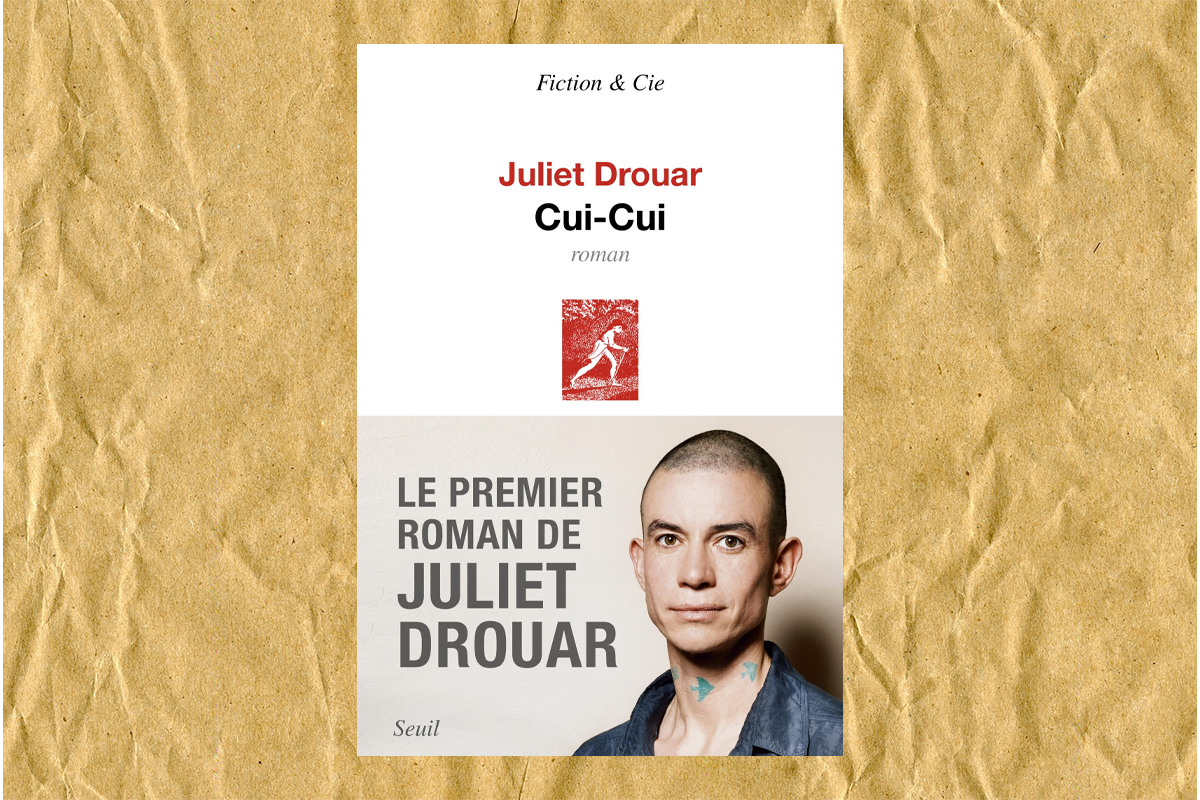
Cui-Cui, de Juliet Drouar :
le langage comme lieu de lutte
Cui-cui est une dystopie dans laquelle des mineurs de 13 ans votent pour la première fois. Ce droit entraîne une réflexion sur le langage comme lieu de lutte pour l’égalité des genres, la formation d’une identité et la dénonciation de crimes sexuels, d’inceste notamment.
Milly La Delfa, professeure de lettres (académie de Paris)
Cui-cui est une dystopie dans laquelle des mineurs de 13 ans votent pour la première fois. Ce droit entraîne une réflexion sur le langage comme lieu de lutte pour l’égalité des genres, la formation d’une identité et la dénonciation de crimes sexuels, d’inceste notamment.
Milly La Delfa, professeure de lettres (académie de Paris)
Cui-cui, premier roman de Juliet Drouar, est un livre troublant qui engage à repenser le rapport du langage avec le réel et l’efficacité d’une pratique queer de la langue pour faire entendre des voix inaudibles. « Cui-cui », c’est l’onomatopée qui s’échappe d’une gorge étranglée par les violences que la « narrateurice[1] » n’arrive pas à dire, c’est à la fois un cri d’alerte, de désespoir et une nouvelle identité. Cui-cui, c’est aussi l’histoire d’une professeure qui apprend à entendre un•e élève qui se tait car « les silences sont toujours chargés d’un nombre incalculable de mots[2] ».
« Le langage est un lieu de lutte » : déstabiliser le genre
En 2018, la chercheuse française Mona Gérardin-Laverge prend appui sur les travaux de la philosophe américaine Judith Butler, et en particulier sur son essai Trouble dans le genre[3], pour repenser le rapport du langage avec le réel. Elle invite à ne plus considérer le langage comme transposition linguistique des différences de genres, mais comme agent même de leur construction. Les mots et la grammaire sont susceptibles de participer activement à la reproduction des inégalités, voire à leur surgissement. Elle propose alors de considérer le langage comme un véritable « lieu de lutte[4]», d’où pourrait advenir l’abolition du genre ou au moins sa « dénaturalisation[5] ».
Ce questionnement sur le rôle du langage dans la formation d’une identité, la romancière Camille Laurens s’en était emparé dans Fille[6], roman dans lequel la voix narratrice donnait à entendre la force performative du langage : « C’est une fille.Ça commence avec un mot, comme la lumière ou comme le noir[7].»
Lors de cette rentrée littéraire de janvier 2025, Juliet Drouar propose une écriture qui déstabilise le genre de façon beaucoup plus radicale. Mise en œuvre par l’usage ponctuel des pronoms non-genrés « Iels arrivent à la queue leu leu dans un silence de mort[8] », par l’alternance des accords ou l’usage de formes inclusives : « On s’avance toustes timidement vers ces foutues grilles, nerveuses et curieux[9] », la langue crée une faille entre la façon dont la « narrateurice » parle de lui-même – au masculin – et celle dont les autres parlent d’elle – au féminin – afin d’inviter le lecteur à faire chemin aux côtés d’un être dont il s’agit surtout de percevoir les souffrances et les émois, par-delà une vision binaire et les stéréotypes de genre.
Se comprendre « peut-être aussi en parlant de nouveaux mots[10] »
Loin d’être un artifice littéraire, cette langue est le reflet d’un impératif politique : l’usage figé des mots n’est peut-être pas apte à transmettre ces nouveaux récits qui cherchent à rendre compte au plus près des sensations et des flux de pensée de la « narrateurice ». Mise au défi d’exprimer la vie intérieure de son personnage, Édouard Dujardin avait adopté, en 1887, dans son roman Les Lauriers sont coupés, tout entier construit sur un monologue intérieur, la récurrence du point-virgule.
Juliet Drouar fait du rythme syncopé et d’un vocabulaire urbain le véhicule le plus efficace de ce qui se passe dans la tête de son personnage : « Je me répète dans ma tête “Que me vaut le plaisir de votre visite ?”Et là tout d’un coup l’image de mon père s’impose. Genre le man débarque en gros plan et même au premier et seul plan. Je sais même pas si on peut dire “de ma conscience”, c’est beaucoup plus graphique, genre il me bouche carrément la vue[11] ». Et, un peu plus loin : « J’ai la bouche hyper sèche. Genre c’est la porte du désert. Derrière, une immense étendue aride. Blanc-jaune as fuck sous un soleil de plomb. »
Cette violence que le texte commet contre la langue « littéraire » fait écho à la violence dont est victime l’adolescent•e : soumis aux désirs incestueux de son père, à l’aveuglement (consenti ?) de la mère, il lui faut aussi se soumettre aux comportements auto-destructeurs que l’emprise des adultes a inscrits en lui-elle. Dans le rythme heurté de l’écriture et les réticences du récit, les drames se disent à demi-mots : « Ce qu’elle voulait dire c’est qu’avant le collège les enfants c’est trop transparent, ils font et donnent à voir ce qu’on leur fait. Par association d’idées, une bulle souvenir remonte : une fois, j’ai, ma sœur. »L’adolescent•e se rend dans la chambre de son père quand sa mère n’est pas à la maison. Ce n’est évidemment pas de son plein gré. Mais iel ne s’appartient tellement plus, iel a été si bien colonisé•e par le désir du père que ses jambes le portent malgré lui-elle. Il n’y a pas consentement, il y a dépossession de soi. Et seuls les mots que l’on apprend à RE-dire ouvrent une brèche : « Je suis si coincé dans ma camisole, au secours. J’ai une zipette sur la bouche. Je tire sur mes manches et j’ai des larmes qui coulent ? Je me tortille. C’est trop. »
Recueillir ces récits
Ce roman met face-à-face puis contre, tout contre, une professeure, Gisèle et son élève. À la suite d’une intervention sur des agressions sexuelles dont les mineurs peuvent être victimes, la « narrateurice » se rend dans le bureau de sa professeure. Il faut plusieurs rendez-vous pour que l’élève puisse dire quelque chose et pour que la professeure trouve le moyen de faire place à cette parole.
Le livre donne à lire la difficulté intime et professionnelle de permettre à ces récits d’advenir et de savoir quoi faire une fois qu’ils sont advenus. S’il y a le cadre légal que le roman rappelle, les professeurs ont l’obligation du signalement, il y a également la peur légitime de ne pas agir comme il le faudrait, de ne pas être la bonne personne-ressource : « Je me dis que je ne sais pas quoi faire et c’est tellement angoissant…– Oui. – J’ai eu peur de mal faire. Et aussi au fond… Gisèle regarde effectivement au fond de son crâne un long moment puis ferme les yeux en disant doucement, comme un aveu : – J’ai tellement peur qu’elle se tue et d’en être responsable. »
Cui-cui bouscule et prend aux tripes, mais fait entendre une voix nouvelle pour tenter, encore une fois, de briser le silence qui toujours retombe sur le scandale de l’inceste.
M. L. D.
Juliet Drouar, Cui-Cui, Seuil, Paris, 2025
Notes
[1] Afin de respecter le choix de l’auteur de ne pas genrer formellement son personnage, l’article respectera, dans la mesure du possible, le maintien de cette non-binarité.
[2] Juliet Drouar, Cui-Cui, Seuil, Paris, 2025, p. 114.
[3] Butler Judith, Trouble dans le genre, traduction française de Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 2005.
[4] Titre de la thèse de Mona Gérardin-Laverge soutenue le 14 décembre 2018, université Paris 1.
[5] Gérardin-Laverge Mona, Queeriser la langue, dénaturaliser le genre Cahiers du Genre, vol. 69, no 2, 2020.
[6] Camille Laurens, Fille, Gallimard, Paris, 2020.
[7] Ibid, p. 12.
[8] Juliet Drouar, Cui-Cui, Seuil, Paris, 2025, p. 38.
[9] Ibid. p. 57.
[10] Juliet Drouar, billet de blog 30 juin 2020 https://blogs.mediapart.fr/juliet-drouar/blog/300620/femme-n-est-pas-le-principal-sujet-du-feminisme.
[11] Juliet Drouar, Cui-Cui, Seuil, Paris, 2025, p. 52.
