« Les Moissons funèbres », de Jesmyn Ward
Après le remarquable Fairyland, d’Alysia Abott, qui faisait le portrait de son père dans le San Francisco gay des années 70, les éditions Globe publient le nouveau livre de Jesmyn Ward, Les Moissons funèbres, qui retrace la vie de quelques jeunes et de l’auteur dans le Mississippi des années 2000.
Les Moissons funèbres, troisième livre de Jesmyn Ward, jeune auteure américaine qui a déjà reçu le National Book Award et d’autres prix prestigieux pour ses deux premiers romans (Ligne de fracture et Bois sauvage, Belfond), est un livre étrange et beau où l’écrivain abandonne le masque de la fiction pour livrer ses propres souvenirs.
Une construction alternée de biographies de cinq jeunes hommes, dont son frère, tués alors qu’ils viennent tout juste de dépasser la vingtaine, et de tranches de vie personnelle font de ce livre un mémoire, comme le précise le sous-titre de l’édition américaine. Il est en effet écrit en hommage aux jeunes qui sont morts alors que l’auteure commençait à s’affranchir de l’existence dure et presque toujours vouée à l’échec du Sud rural.
.
In memoriam
Il y a trois semaines, Darren Seals, le leader de la cause noire à Ferguson, a été retrouvé mort, tué par balle, dans une voiture calcinée. L’enquête de la police est d’ores et déjà suspectée de ne pas vouloir aboutir, ajoutant ainsi au long cortège des crimes non élucidés dont sont victimes les activistes afro-américains. Nous sommes pourtant dans l’Amérique d’Obama dont le bilan est soutenu par de nombreux écrivains, comme l’a montré la série d’articles parue dans le quotidien Libération à la fin du mois d’août.
Le livre de Jesmyn Ward se situe quelque part en amont de cette récente mobilisation, car elle refuse explicitement de croire à une Amérique post-raciale. Elle ne parle cependant que d’elle-même et de son entourage, il n’y a pas d’affrontement direct, pas de drame mis en scène par les médias, juste le lot commun des Noirs habitant les quartiers déshérités de la petite ville de DeLisle.
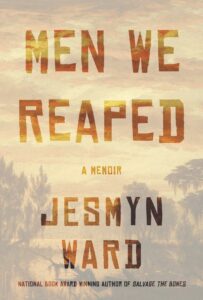 Si elle évoque elle aussi une enquête bâclée, il s’agit de celle que l’on consacrera à l’accident de son frère dont la voiture emboutie par un chauffard blanc et ivre sera le tombeau. Joshua, c’est son nom, n’est pas exécuté par un policier, mais il est le déclencheur de l’œuvre. Son titre original, Men We Reaped, le dit : Les hommes que nous avons moissonnés ; ce sont les jeunes hommes de la communauté qui disparaissent dans l’indifférence de la société.
Si elle évoque elle aussi une enquête bâclée, il s’agit de celle que l’on consacrera à l’accident de son frère dont la voiture emboutie par un chauffard blanc et ivre sera le tombeau. Joshua, c’est son nom, n’est pas exécuté par un policier, mais il est le déclencheur de l’œuvre. Son titre original, Men We Reaped, le dit : Les hommes que nous avons moissonnés ; ce sont les jeunes hommes de la communauté qui disparaissent dans l’indifférence de la société.
L’école, qui devrait aider, ne fait plus son travail depuis longtemps :
« En tant que jeune Noir réussissant mal, il était perçu comme un problème. Et à cette époque l’administration scolaire résolvait le problème du jeune Noir par une forme de négligence sympathique. Plus tard, cette négligence deviendrait franche hostilité, avec fouilles illégales des collégiens accusés de dealer et rédaction de rapports sur leur compte – des pages et des pages de rapports consignant leurs infractions réelles ou imaginaires et qui permettraient, une fois que les dossiers auraient atteint l’épaisseur requise, de les virer pour protéger le classement de l’établissement et sa réputation. »
Alors l’auteure dresse elle-même des stèles pour marquer leur passage, elle restitue les personnages dans leur vie, mais jamais de façon morbide.
.
Des morts et une vie
Le principe du livre est donc assez simple en apparence : Jesmyn Ward évoque les vies de cinq jeunes hommes de son entourage morts dans un laps de temps relativement court (quatre ans) tandis qu’elle-même suit sa voie et retrace la vie qu’elle a menée.
Si l’on devait s’arrêter à la disparition de chacun des protagonistes on relèverait une liste conforme à l’idée qu’on se fait de la situation dans la communauté afro-américaine – overdose, suicide, meurtre. Mais ce n’est pas aussi simple, le suicide est celui d’un jeune homme amoureux, l’overdose revêt une forme de suicide, seul le meurtre d’un jeune qui s’apprêtait à témoigner contre un assassin prend une tournure tragique telle qu’on peut la voir à travers les clichés des séries policières.
Jesmyn Ward raconte avant tout la vie de ses proches : pourquoi meurent-ils autant se demande-t-elle ? Elle trouve la réponse. Le plus grand danger c’est l’absence de confiance en soi liée à l’absence de perspectives. S’ils ne peuvent s’extraire de leur communauté c’est aussi que ces jeunes ne trouvent même plus les petits boulots qui faisaient vivre la génération précédente. Mais également parce que même s’ils émigrent vers des États plus riches comme la Californie, le Sud leur manque et cette dernière raison peu rationnelle achève de nous les rendre humains et pas seulement sociologiquement prédestinés.
En parallèle, le livre développe aussi une histoire de sa famille qui montre ce qu’il y a derrière la misère et les bons de ravitaillement alloués aux familles pauvres.
Sa mère par exemple renonce dès le début du livre à la Californie qu’elle aimait pourtant mais dont son mari la détourne :
« […] elle aimait les paysages, les villes et les collines à perte de vue. Le Mississippi est un État sans beaucoup de relief et les forêts vous empêchent de voir plus loin que la maison d’à côté, le chien attaché à un arbre, le garçon qui fait du vélo sur la route. »
Mais elle devra se résoudre à faire des ménages pour que sa fille survive. « Ici, la famille a toujours été un concept mouvant. Il arrive qu’elle recouvre l’ensemble de la communauté », on va s’installer chez un cousin mais indifféremment chez un membre de la même communauté dont on se sent proche. Sa propre histoire semble tracée. C’est la fille aînée qui doit faire marcher la maison lorsque son père les quitte.
Jamais dure avec celui-ci, elle trace le portrait édifiant d’un homme immature et peu inspiré, qui rêve d’ouvrir des cours d’arts martiaux mais sans succès, ce qui le surprend au premier chef, qui fait main basse sur les économies du couple pour s’acheter une moto, inutile, mais qui rehausse son prestige viril dans sa soif de conquêtes féminines.
En outre, Jesmyn Ward ne se montre jamais à son avantage, et c’est un des atouts de cette œuvre. Il ne s’agit pas du récit d’une ascension fulgurante (elle a pourtant été nommée maître de conférences en écriture créative à l’université de l’Alabama du Sud). Au contraire, elle est un peu gauche et se sent maladroite. Elle croit résoudre ses problèmes en s’enivrant – everclear (alcool de maïs entre 75 et 90 degrés), bière le plus souvent, mais aussi blunt (marijuana) –, mais tombe malade lorsqu’elle boit…
« Nous buvons en silence, pour oublier. Pendant l’été 2004, nous nous sentons déjà vieux ; à la fin de l’été, nous saurons que nous avons un pied dans la tombe. »
On suit pourtant sa progression.
La communauté afro-américaine est à l’écart et on sait que les policiers blancs ne sont jamais bien loin ; il s’agit de ne pas se faire remarquer, comme le dit l’un des protagonistes. Tant que l’on reste à l’intérieur de sa communauté, la vie peut s’écouler, bien évidemment exposée aux dangers de la rue de la misère et de l’instabilité familiale. L’héroïne échappe de peu à un viol, se fait agresser par le pitbull de son père, monte souvent dans des voitures dont on ne sait pas vraiment qui les conduit ni, surtout dans quel état.
C’est lorsqu’elle tente de s’arracher à cet univers pour étudier qu’elle rencontre les véritables difficultés : on l’attaque à l’école publique des Noirs, et on l’humilie dans l’école privée des Blancs dont sa mère est la femme de ménage. Elle rencontre alors le vieux racisme sudiste :
« Ils recommencèrent à rire et à se donner des coups de coude, et là je compris. Il était question d’une personne noire, les mains attachées, une corde autour du cou, un pique- nique. Un lynchage. Ils parlaient de lynchage et ça les faisait rire. »
Elle tient tête et se sent fière, mais devant l’indifférence des autres élèves elle se résigne :
« Je compris que je n’avais rien obtenu du tout. J’étais toujours la même. Et j’étais seule. »
.
Naissance d’un écrivain
Dans un premier temps cette résignation l’emporte, elle refuse d’écrire sur sa communauté alors que certains décèlent en elle la possibilité de se faire entendre ; trop tendre encore, elle ne veut pas qu’il leur arrive ce qui se passe dans leurs vraies vies :
« Je ne sais pas comment aimer moins mes personnages. Comment regarder en face la réalité de ce qui arrive aux jeunes Noirs du Sud et comment la retranscrire honnêtement dans mes écrits. Comment être un dieu style Ancien Testament. Pour éviter de me poser trop de questions, je bois. »
Elle choisit finalement la démarches des mémoires, rappelle d’outre-tombe les vies de ces jeunes qu’elle a connus beaux et forts et qui la fascinaient lorsqu’elle grandissait lentement. En substituant leurs destinées mélancoliques à sa propre réussite elle met aussi le doigt, pour elle-même, sur ce qui a fait le terreau de son écriture.
Le titre original de Moissons funèbres, Men We Reaped, est tiré d’un livre d’Harriet Tubman (1820-1913), militante anti-esclavagiste, esclave elle-même vendue à l’âge de six ans, qui parvint à faire évader nombre des siens du Sud vers le Canada, et qui écrivit :
« Nous avons vu des éclairs, et c’étaient des fusils ; puis nous avons entendu le tonnerre et c’étaient des canons ; puis la pluie s’est mise à tomber et c’était du sang qui coulait ; et quand nous sommes allés ramasser les récoltes, ce sont des hommes morts que nous avons trouvés. Funèbres moissons. »
Jeysmin Ward reprend cette phrase en épigraphe à son livre qu’il faut lire pour ce qu’il est : le récit d’une écrivaine qui sait en une métaphore faire percevoir la profondeur de son sujet sans jamais un instant être pesante : « J’ai appris récemment que le terrain sur lequel a été construit notre parc va être converti en cimetière quand celui de la ville sera devenu trop petit ; un jour, nos tombes engloutiront notre terrain de jeux. »
Cette autobiographie qui s’écrit en se mêlant aux vies des autres trop tôt disparus ajoute à la collection « Globe » « l’inflexion des voix chères qui se sont tues ».
Frédéric Palierne
.
• Vidéo : entretien avec Jesmyn Ward :

• Jesmin Ward, « Les Moissons funèbres », traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédérique Pressmann, Éditions Globe, 2016, 272 pages.
• Alysia Abbott, “Fairyland”, traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard, Éditions Globe, 2015, 384 p.
• Sur la conquête des droits civiques aux États-Unis, voir : « Wake Up America, I. 1940-1960, II. 1960-1963 », de John Lewis, Andrew Aydin et Nate Powell, Rue de Sèvres, 2014 et 2015.

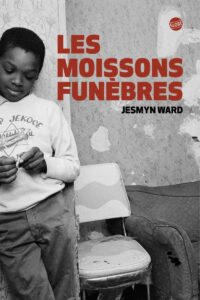

Je viens de terminer ce livre et j’en suis bouleversé.
Jeysmin Ward m’a percé le cœur avec son témoignage à la fois sobre, tendre, dur et tellement véridique.
Qu’un être humain soit aussi bléssé dans son moi le plus profond n’est pas acceptable.
Est-il possible de lui envoyer un courrier directement ou par votre intermédiaire?
Merci beaucoup d’avoir édité ce grand livre.