
Le Comte de Monte-Cristo,
de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière :
cure de jeunesse
Adapter un classique du XIXe siècle tel que Le Comte de Monte-Cristo, c’est partir à la recherche du romanesque et d’hommes pittoresques, critiquer l’argent roi et vivre des aventures farouches. Malgré l’ampleur du projet, Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière brillent par leur retenue et offrent au Comte une cure de jeunesse.
Par Philippe Leclercq, critique
Adapter un classique du XIXe siècle tel que Le Comte de Monte-Cristo, c’est partir à la recherche du romanesque et d’hommes pittoresques, critiquer l’argent roi et vivre des aventures farouches. Malgré l’ampleur du projet, Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière brillent par leur retenue avec un héros seul et désolé.
Par Philippe Leclercq, critique
Dire qu’Alexandre Dumas est un des écrivains français les plus portés à l’écran relève presque de l’euphémisme. Ses œuvres romanesques et théâtrales ont inspiré plus de deux cent cinquante films dans une vingtaine de pays. Dès l’époque du muet, Le Comte de Monte-Cristo, roman-feuilleton écrit avec la collaboration d’Auguste Maquet et publié entre 1844 et 1846, compte à lui seul quatorze adaptations en France, aux États-Unis et en Italie. Le récit dumasien, mêlant la peinture sociale au romanesque, l’action au mélodrame, se prête particulièrement au cinéma de genre. Superproductions et films à épisodes se succèdent alors avec succès. En 1954, le metteur en scène Robert Vernay tourne le remake de sa propre version datant de 1943. Jean Marais y remplace l’excellent Pierre Richard-Willm dans le rôle d’Edmond Dantès, et propulse le film, grâce à ses prouesses d’acteur autant qu’aux aventures de son personnage, en tête du box-office national avec près de huit millions de spectateurs.
Dantès avant Monte-Cristo
Depuis, l’appétit des cinéastes et producteurs pour Dumas n’a jamais faibli. Tandis que la chaîne de télévision France 2 annonçait il y a peu la diffusion, pour la fin de l’année 2024, d’un nouveau Comte de Monte-Cristo en huit épisodes de cinquante minutes, réalisé par le cinéaste danois Bille August (double Palme d’or à Cannes en 1988 et 1992), voilà que débarque sur grand écran pour l’été la version de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, par ailleurs scénaristes du récent diptyque des Trois Mousquetaires, de Martin Bourboulon (2023).
Cette adaptation démarre fort, in media res, en pleine nuit et au cœur d’une mer démontée. Là, le Pharaon, un navire marchand sur lequel travaille le jeune Edmond Dantès, croise un bâtiment en perdition. Une femme est à l’eau, au bord de la noyade. Edmond, le cœur vaillant, plonge et la sauve. Nous sommes en février 1815, peu avant Waterloo, une époque où il ne fait pas bon être bonapartiste. Or, Angèle, la jeune femme sauvée des eaux, est porteuse d’un ordre de mission signé de la main même de l’empereur, que lui confisque aussitôt le capitaine de bord, Danglars.
On connaît la suite : jaloux que l’armateur Morrel lui préfère Dantès pour commander son navire, Danglars ourdit un complot, avec l’aide du procureur Villefort et de Morcerf, l’ami d’Edmond, pour le faire passer pour bonapartiste, l’enlever aux siens le jour de son mariage avec la belle Mercédès, et l’envoyer dans une geôle du château d’If où il croupira pendant quatorze ans. Là, il rencontrera l’abbé Faria qui fera son éducation et sa fortune en lui révélant, avant de mourir, l’existence d’un trésor fabuleux. Parvenu enfin à s’évader, Edmond reviendra à Paris sous les nouveaux traits du richissime comte de Monte-Cristo pour se venger de ses anciens bourreaux…
Entre Balzac et Ponson du Terrail
Tenter aujourd’hui l’aventure de l’adaptation d’un classique de la littérature du XIXe siècle tel que le Comte de Monte-Cristo, c’est partir à la recherche d’une forme disparue du romanesque, au carrefour de la profondeur psychologique d’un Balzac (le modèle de Dumas), de l’effroi gothique d’une Radcliffe et du souffle rocambolesque d’un Ponson du Terrail – le secret croisé de la bonne fortune tant littéraire que cinématographique de Dumas ? C’est entreprendre la peinture d’une galerie d’hommes pittoresques, malfrats et bourgeois confondus dans le même élan d’intérêts voraces ; c’est faire la critique de l’argent roi et des pouvoirs qui le servent à l’époque de la Restauration (qui présente bien des résonances avec la nôtre) ; c’est vivre enfin des aventures farouches, faites de détours, pièges, rebondissements et coups de théâtre. Et tout cela à toute vitesse, à l’écran comme à l’écrit, comme le souligne l’éminent Jean-Yves Tadié dans l’édition « Folio » du roman : « La progression du récit se fait selon un rythme savant de tension et de détente, le comique, les scènes d’amour, apportant un soulagement momentané au lecteur, puis le récit repart de plus belle : l’auteur se dit lui-même ‘‘entraîné par la rapidité du récit’’… »
Vigueur et classicisme de la mise en scène
Évitant l’écueil de l’emphase du film à grand spectacle, les deux scénaristes-réalisateurs Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière ont préféré la modération dramatique aux effets de manches esthétiques, les tourments introspectifs à la rage démonstrative du héros éponyme que le destin a transformé en « machine à vengeance ».
Non que les quelque 43 millions d’euros de budget du film ne soient visibles à l’écran – la somptuosité des décors intérieurs et extérieurs s’accorde autant à la toute-puissance du protagoniste qu’à l’immense intensité du récit –, cette nouvelle adaptation du roman d’Alexandre Dumas brille par une certaine forme de retenue, sinon de modestie de la forme au service de la narration et de son héros, seul moteur de l’action.
Jamais surplombante, la mise en scène n’obéit à aucun mouvement superflu, ni fragmentation de l’action propre au film d’aventures (pas de montage épileptique à l’américaine ici). Le dispositif s’appuie sur une suite très fluide de tableaux, emblématiques des scènes du roman soigneusement découpées et recomposées avec un souci évident de lisibilité dont témoignent les traditionnels cartons qui en rythment la progression.
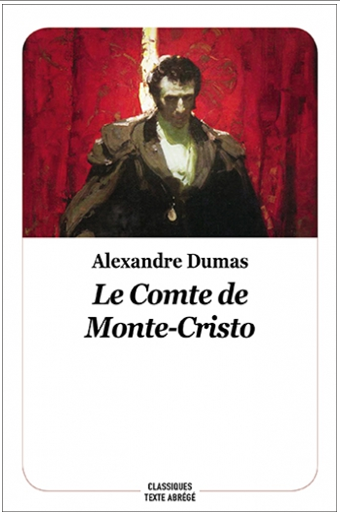
collection « Classiques », l’école des loisirs, 2019
Une lumière solaire, qui va s’obscurcissant, éclaire toute la première partie du film et la candeur du héros dont les larges sourires et le regard franc (Pierre Niney, parfait dans le registre de la naïveté) s’opposent aux coups d’yeux torves de ses ennemis : le capitaine Danglars, le procureur Villefort, le comte de Morcerf et Caderousse – ce dernier étant quelque peu sacrifié et réduit ici à une simple silhouette.
Comme lui, nombre de protagonistes du roman ont disparu, à l’image de Noirtier, le père bonapartiste de Villefort, et de toute la famille, femme et enfants, de ce dernier. En remplacement, les cinéastes lui ont inventé une sœur bonapartiste – l’Angèle du début du film –, manière pour eux d’escamoter les longs développements familiaux tout en resserrant la tension autour du cruel esprit d’intrigue du personnage (impressionnant Laurent Lafitte).
Même effet de condensation et de réécriture des Danglars et Moncerf, qui subissent une cure d’amaigrissement de leur caractère les réduisant à leurs vices et défauts : la cupidité, la duplicité, la brutalité, le cynisme. Un certain nombre de traits, y compris celui de faire de l’argent l’instrument de la destruction des autres, dont héritera Edmond après son passage au château d’If. Passage dont on regrettera la portion congrue dans l’économie du film. Craignant sans doute une trop longue baisse de rythme, les réalisateurs ont limité la rencontre avec l’abbé Faria, pourtant si déterminante dans la formation intellectuelle et la renaissance d’Edmond en Monte-Cristo, à un face-à-face sans grande profondeur, si ce n’est celle, plus cinégénique, de voir les personnages creuser la terre et les moyens de leur fuite.
Conflit moral de la vengeance
Après la scène de l’évasion soumise à un solide suspense, s’ouvre la troisième grande partie du récit, morceau de choix des aventures du héros devenu tout-puissant, où il s’agit moins pour les cinéastes de spéculer sur les attentes du lecteur-spectateur qui connaît les principaux épisodes du récit, que de renouveler quelques-unes des facettes du nouveau vengeur. Et ce, à commencer par sa capacité à se jouer de la crédulité de ses victimes, et à sa manière de se présenter à elles sans être reconnu pour, telle une créature arachnéenne, les étouffer dans sa toile.
Moins cruel que dans le roman, Monte-Cristo, le visage grave et douloureux (transformation convaincante de Pierre Niney en Monte-Cristo), apparaît ici comme un être déchiré, en lutte avec lui-même. Celui-ci, qui a pourtant eu deux pères (le vieux Dantès et Faria) et qui possède deux enfants adoptifs (Haydée et Andrea), est un homme seul, isolé, désolé ; libre, il vit prisonnier de sa tragique détermination, de son obsession morbide à se venger de ses anciens bourreaux (à l’image d’un Bruce Wayne, le milliardaire qui se dissimule sous le masque de Batman). Plutôt réussis, les choix plastiques de mise en scène – intérieurs lourds et gothiques, éclairage fuligineux, costumes noirs – offrent ainsi de beaux échos à sa solitude mortifère, au deuil de lui-même qu’il porte en lui et au poids moral grandissant de son machiavélisme.
Les nombreux masques qu’il possède et qu’il manipule souvent, comme témoignage de la science de la dissimulation qu’il a acquise, lui renvoient une image diffractée de lui-même, dans laquelle il ne retrouve plus celui qu’il a été, ni celui qu’il est devenu. Aveuglé par les super-pouvoirs que sa richesse illimitée lui confère, il est menacé de se perdre et de s’aliéner la haine des deux femmes (Haydée et Mercédès) qu’il est encore capable d’aimer. Aussi, la résolution inattendue du conflit moral de la vengeance, inédite par rapport au roman, aura valeur de rachat et fera réapparaître in fine quelque trace d’une humanité enfouie sous le masque de la haine et de la vengeance.
Avec sa jeune distribution au jeu délié (Anaïs Demoustier, Bastien Bouillon, Patrick Mille…) et son honnête mise en scène aux dialogues soignés (très fidèles au roman), le Monte-Cristo de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière accorde au héros mythique de Dumas une nouvelle et belle jeunesse, inscrite dans la meilleure tradition du cinéma populaire.
P. L.
Le Comte de Monte-Cristo, film français de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière. Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Bastien Bouillon (2 h 58). Sortie en salle vendredi 28 juin.
Ressources L’École des lettres
- Alexandre Dumas : « Le Comte de Monte-Cristo ». Étude intégrale (séquence)
- Alexandre Dumas : « Le Comte de Monte-Cristo ». Du feuilleton au roman (séquence)
- Expo « Alexandre Dumas à l’écran » : quand Dumas fait son cinéma
L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.
