« Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des plaines) », d’Arnaud Desplechin
 Avec Jimmy P., Arnaud Desplechin livre probablement son meilleur film, depuis La Vie des morts (1991), La Sentinelle (1992), Comment je me suis disputé (1996), Rois et reines (2004).
Avec Jimmy P., Arnaud Desplechin livre probablement son meilleur film, depuis La Vie des morts (1991), La Sentinelle (1992), Comment je me suis disputé (1996), Rois et reines (2004).
Jimmy P reprend le thème des fantômes d’une guerre passée, comme dans La Sentinelle, et son acteur fétiche Mathieu Amalric pour faire mesurer l’apport exceptionnel de l’ethnopsychanalyste franco-américain Georges Devereux.
Le film retrace en particulier sa rencontre décisive avec un soldat américain, Indien Pied Noir (Black Foot) d’origine, ayant combattu en France.
Après la deuxième guerre mondiale, Jimmy Picard, à la suite d’un accident de combat, souffre de troubles graves (maux de tête, insomnies, cécité et surdité occasionnelles) et il est hospitalisé au Winter Veteran Hospital installé à Topeka (Kansas), où il est confié aux bons soins du pionnier de l’ethnopsychiatrie.
À l’origine du film, le compte rendu d’une analyse
conduite par l’ethnopsychiatre Georges Devereux
Inspiré du livre de Georges Devereux, Psychothérapie d’un Indien des plaines (Fayard), compte rendu intégral, séance après séance, de l’analyse de cet ancien combattant traumatisé, le film, magnifiquement interprété par Benicio del Toro, nous fait vivre la façon dont il réapprend à vivre normalement grâce au contact personnel que son psychanalyste parvient à établir avec lui.
 Selon l’usage, Devereux dissimule soigneusement la véritable identité de Jimmy. Arnaud Desplechin joue de cet anonymat, qui épaissit encore le mystère déjà inhérent à la personnalité du soldat et dramatise sa lente résolution, dont il fait une recherche palpitante.
Selon l’usage, Devereux dissimule soigneusement la véritable identité de Jimmy. Arnaud Desplechin joue de cet anonymat, qui épaissit encore le mystère déjà inhérent à la personnalité du soldat et dramatise sa lente résolution, dont il fait une recherche palpitante.
Nourri d’images collectées par son ami Alexandre Nazarian, envoyé en éclaireur sur les lieux réels de l’histoire, le cinéaste a longuement travaillé les personnages, le décor – la clinique du psychiatre Karl Menninger, chargé par l’armée américaine de former de nombreux psychologues et psychiatres –, et reconstitué soigneusement accessoires, ambiances et lumières.
C’est ce qui donne un air un peu rétro à cette œuvre qui non seulement raconte les premières expériences de l’ethnopsychiatrie, mais filme cette longue analyse à la façon des années 50.
Un documentaire de 1945
et une fiction de 1963 en arrière-plan du scénario
Il s’inspire d’ailleurs de deux films anciens. Le premier est Let There Be Light (que la lumière soit!), documentaire de John Huston, commandé et produit par l’armée américaine en 1945, sorti en 1946 et aussitôt censuré pendant plus de trente ans après une vive polémique. Il montre en effet pour la première fois les maladies mentales et le stress post-traumatique des soldats revenus du front, les traitements qui leur sont appliqués – hypnose, psychothérapie, électrochocs – et leur difficile réadaptation à la vie civile.
 Le film n’a été montré publiquement pour la première fois qu’en 1980. On peut aujourd’hui le visionner en ligne sur le site de la National film Preservation Foundation.
Le film n’a été montré publiquement pour la première fois qu’en 1980. On peut aujourd’hui le visionner en ligne sur le site de la National film Preservation Foundation.
Le second film est une fiction à trois personnages principaux, deux médecins et une infirmière, Captain Newman, M.D. (Le Combat du capitaine Newman), sorti en 1963 et réalisé par David Miller, avec dans les rôles principaux Gregory Peck, Tony Curtis et Angie Dickinson.
Il décrit le difficile travail du capitaine Josiah Newman, qui dirige le centre de neuropsychiatrie de la base de Colfax et se voit chargé d’analyser les patients pour être sûr qu’ils ne font pas semblant d’être malades.
Fabriquer de la fiction à partir de faits avérés
Arnaud Desplechin mêle habilement sources documentaires – photos de soldats de cette époque et portraits de vétérans indiens actuels – et souvenirs fictionnels, y compris l’approche hitchcockienne de la psychanalyse dans des œuvres comme Vertigo. Sa méthode paradoxale consiste à fabriquer de la fiction à partir des faits avérés tout en respectant la réalité du contexte historique et en inventant délibérément des personnages comme celui de Madeleine, l’amie de Devereux, à partir de données biographiques.
Tout commence par la première question posée à Jimmy, celle de son son nom indien. Quand Devereux, qui parle la langue pikanii, parvient à le traduire par « Everybody-talks-about-him » (tout le monde parle de lui), il détient une première clef et le véritable travail peut commencer. Le dialogue s’instaure en anglais, en pikanii et dans la langue des signes, dialogue non pas inquisiteur mais compréhensif, en empathie, constructif.
La question du rapport à l’identité
Au fil des séances, Jimmy, mis en confiance, se livre de plus en plus, parvient à raconter ses rêves et à se remémorer des souvenirs refoulés. Le sujet du film se révèle progressivement être le rapport complexe de chacun des personnages à son identité.
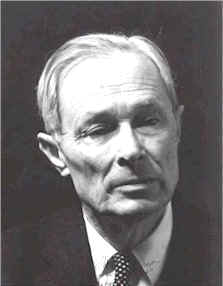
C’est peut-être parce que Devereux – juif roumain, de son vrai nom Győrgy Dobó, ayant pris un autre nom et une double nationalité – ne se sent appartenir à aucune et fuit toute forme d’identité, qu’il reconnaît à quel point il est important pour Jimmy de renouer avec la sienne, tandis que Madeleine, elle, est l’exemple type d’une identité assumée puisqu’elle se sent tout à fait européenne, ne veut pas être autre chose, et se trouve parfaitement bien dans sa peau.
Rapprochés par cette commune difficulté, par ce trouble de l’identité, deux êtres qui n’avaient rien de commun se lient d’amitié et partagent sous nos yeux une aventure humaine sans précédent, qui a validé des hypothèses et construit une discipline. Il faut cependant remarquer, avec son disciple Tobie Nathan, que si Georges Devereux, intellectuel occidental immigré en Amérique, psychanalysait un membre d’une tribu autochtone, l’ethnopsychiatrie moderne travaille à l’inverse, puisque des psyschanalystes autochtones tentent maintenant de soigner de manière spécifique des immigrés de tous les pays.
Un sujet d’une grande humanité et d’une actualité brûlante
Mathieu Amalric est excellent dans le rôle délicat de ce polyglotte proche des milieux artistiques et littéraires européens, de cet anthropologue élève de Marcel Mauss et de Lucien Lévy-Bruhl à Paris, d’Alfred Kroeber et de Robert Lowie à Berkeley, qui a vécu avec les Indiens Mohave.
Le réalisateur a accentué le côté précieux du personnage jusqu’à le rendre un peu caricatural (il en fait une sorte d’Hercule Poirot de la psychanalyse). Mais la première surprise passée, cette préciosité apparaît comme l’envers d’une conscience professionnelle anxieuse attachée à examiner méthodiquement et méticuleusement tous les aspects de la personnalité complexe du patient. Et comme une façon pudique de dissimuler une exceptionnelle générosité.
Un sujet très riche intellectuellement, d’une grande humanité et d’une actualité brûlante dans notre société multi-culturelle, une interprétation remarquable, font de Jimmy P. un récit encore plus riche que les études de cas de Freud et un film passionnant, même si son dispositif et la qualité même de ses dialogues font quelquefois penser à du théâtre filmé et expliquent son absence au palmarès du dernier festival de Cannes.
Anne-Marie Baron
• Sur Georges Devereux : des éléments biographiques et une bibliographie exhaustive établis par le Centre Georges-Devereux (Centre universitaire d’aide psychologique aux familles migrantes, émanation de l’université Paris VIII).
• Georges Devereux, père de l’ethnopsychiatrie, entretien avec Tobie Nathan sur France Inter le 10 septembre 2013.
• Georges Devereux et l’ethnopsychiatrie : entretiens et témoignages : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
• Un entretien avec Arnaud Desplechin dans “l’Express” du 13 septembre 2013.
..
