14-18. Écrire la guerre
 La Première Guerre mondiale est au programme de l’École des lettres.
La Première Guerre mondiale est au programme de l’École des lettres.
Labellisé par la Mission du Centenaire, ce numéro propose plusieurs angles d’approche pour explorer un immense champ de lecture, des romans et récits écrits au cœur même du conflit à ceux qui, de nos jours, interrogent encore le cataclysme.
Ce dossier prolonge une série d’études de l’École des lettres sur la littérature et la guerre rassemblées ici.
Il sera régulièrement augmenté de contributions liées aux recherches suscitées par la commémoration du conflit.
14-18. Écrire la guerre
.
 La Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
La Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Entretien avec Alexandre Lafon, historien, conseiller pour l’action pédagogique auprès de la Mission.
La Mission du Centenaire, groupement d’intérêt public créé en 2012, a pour objet de mettre en œuvre, en 2014, les commémorations de la Première Guerre mondiale afin de donner à celle-ci sa pleine dimension historique, sur le modèle du bicentenaire de la Révolution française de 1989.
L’un des enjeux majeurs de ces commémorations est la transmission des mémoires et de l’histoire de la Première Guerre mondiale : il s’agit de la rendre compréhensible et d’en faire un héritage commun partagé, notamment chez les jeunes. Il s’agit de mettre les élèves en position d’héritiers pour « patrimonialiser » cette guerre, au sens vivant du terme, afin qu’ils deviennent eux-mêmes les acteurs de cet héritage.
• Lire l’entretien avec Alexandre Lafon sur ce site.
• Le portail officiel de la Mission du Centenaire.
.
 Lulu et la Grande Guerre, de Fabian Grégoire (« Archimède »).
Lulu et la Grande Guerre, de Fabian Grégoire (« Archimède »).
Cet album, à la fois chronique et témoignage, reprend la correspondance entre Charles mobilisé et sa petite sœur Lucienne.
Il comprend un dossier sur la Grande Guerre avec de nombreuses reproductions de photographies et de documents de l’époque, accessible dès le cycle 3 et en sixième.
• Présentation de l’album.
.
 Le Feu, d’Henri Barbusse, par Magali Jeannin-Corbin.
Le Feu, d’Henri Barbusse, par Magali Jeannin-Corbin.
La lecture du Feu, qui touchera collégiens et lycéens, est particulièrement recommandée pour la classe de troisième. Les élèves doivent, en effet, s’attacher aux « formes du récit aux XXe et XXIe siècles », et notamment aux « romans et nouvelles des XXe et XXIe siècles porteurs d’un regard sur l’histoire et le monde contemporains ».
Sa lecture s’inscrit en outre pleinement dans le thème transversal au programme d’histoire : « Les arts, témoins de l’histoire du monde contemporain ». L’enseignant d’histoire est invité à choisir une œuvre et ou un artiste significatif pour chacune des parties du programme, ce qui implique une approche interdisciplinaire. La lecture du Feu peut donc aisément être mise en relation avec le cours d’histoire, afin d’anticiper et d’accompagner la compréhension des enjeux historiques et culturels de l’œuvre.
• Présentation du livre.
• Pour recevoir gratuitement cette séquence détaillée, écrivez à courrier@ecoledeslettres.fr
..
 Henri Barbusse : acteur, témoin, écrivain ? par Magali Jeannin-Corbin.
Henri Barbusse : acteur, témoin, écrivain ? par Magali Jeannin-Corbin.
Pour Barbusse comme pour ses lecteurs – et ses détracteurs –, la question centrale est celle de la vérité. Il s’élève contre les mensonges du nationalisme, qui dénature la vérité et la morale en les instrumentalisant : « Combien de crimes dont ils ont fait des vertus, en les appelant nationales – avec un mot ! Même la vérité, ils la déforment. À la vérité éternelle, ils substituent chacun leur vérité nationale » (pp. 230-231). Les mots, détournés de leur sens premier, ont ainsi perdu leur vraie signification. Et, pour Barbusse, c’est le bon usage du langage qui conditionne la véracité de la restitution de l’expérience.
 Le manuscrit du Feu, d’Henri Barbusse, sur Gallica / BNF.
Le manuscrit du Feu, d’Henri Barbusse, sur Gallica / BNF.
L’intégralité du manuscrit du Feu a récemment été mise en ligne sur le site Gallica en octobre 2013.
Ce dossier comprend la première version manuscrite du chapitre II : « Dans la terre » ; la copie manuscrite, de la main d’Hélyonne Barbusse, ou dactylographiée, de plusieurs chapitres du Feu ; la copie dactylographiée avec corrections autographes de la main de Barbusse du chapitre XXIV : « L’Aube » ; l’adaptation du roman par Yvonne Lartigaud, dactylographie ; la correspondance adressée à Barbusse au sujet du Feu (en vue d’éditions, de traductions, d’adaptations, de représentations, etc.) ; des coupures de presse relatives au Feu.
 En marge des récits de guerre : insoumis, pacifistes et déserteurs, par Jean-Pierre Tusseau.
En marge des récits de guerre : insoumis, pacifistes et déserteurs, par Jean-Pierre Tusseau.
Si la guerre peut susciter des actes de bravoure et révéler quelques héros nationaux, elle est aussi une période de destruction, de mort, de désolation, pour les soldats du front comme pour les populations civiles, mal approvisionnées, bombardées, contraintes à l’exil, comme en témoigne encore l’actualité. Même une fois achevée, la guerre, par son souvenir, laisse des traces profondes, inguérissables, chez les survivants. Certains auteurs ont ainsi dénoncé la guerre, la misère du peuple, et souligné la nécessité de privilégier les accords de paix ou le refus de prendre part à la violence.
.
 Le Dernier Ami de Jaurès, de Tania Sollogoub, par Jean-Pierre Tusseau.
Le Dernier Ami de Jaurès, de Tania Sollogoub, par Jean-Pierre Tusseau.
Si le premier Noël 1914 a donné lieu à des mouvements de fraternisation dans les tranchées, c’est que, dans les deux camps, se trouvaient des hommes qui ne souhaitaient pas cette guerre et même des réfractaires qui furent fusillés « pour l’exemple ».
Avant qu’elle soit déclenchée, et jusqu’au dernier moment, certains n’ont pas ménagé leur énergie pour défendre la paix, quitte à le payer, eux aussi, de leur vie.
C’est le cas de Jean Jaurès, personnalité riche et attachante qu’évoque Tania Sollogoub dans un roman historique fort bien documenté Le Dernier Ami de Jaurès.
• Présentation du livre.
 Hemingway, de la guerre à l’écriture, par Yves Stalloni.
Hemingway, de la guerre à l’écriture, par Yves Stalloni.
Tout, pour Hemingway, part de l’expérience de la guerre, celle de 1914-1918, qu’il rencontre au sortir de l’adolescence et qui va le transformer. Sa vie, jusqu’alors, est celle d’un jeune homme de bonne famille, fils d’un médecin du Middle West et d’une femme du monde distinguée et musicienne.
Il passe son enfance à Oak Park, près de Chicago où il est né, entouré de ses quatre sœurs et de son frère, ivre de la liberté que lui offre la nature sauvage du lac Michigan où se déroulent les étés en famille. Un peu plus tard, le jeune homme se sent attiré par le journalisme et, grâce à des recommandations, rejoint, en octobre 1917, le Kansas City Star, un quotidien réputé où il devient reporter débutant.
Il entre dans le corps d’ambulanciers de la Croix-Rouge et, en mai 1918, part pour l’Italie. On le nomme à un poste avancé sur les bords du Piave. Le 8 juillet 1918, il n’a pas encore dix-neuf ans, un obus lancé de l’autre côté du fleuve l’atteint aux deux jambes.
 Miette, de Pierre Bergounioux, par Antony Soron.
Miette, de Pierre Bergounioux, par Antony Soron.
En dépit de sa brièveté, ce récit de cent quarante pages au format poche pourrait s’apparenter, nonobstant ses singulières ellipses, à une vaste saga familiale déclinée sur près d’un siècle. L’art narratif de Pierre Bergounioux consiste, avec une rare justesse de trait, à faire cas d’épisodes a priori anecdotiques – et loin de l’imagerie guerrière – qui en disent parfois plus long que la description réaliste des combats. Le plus intéressant dans le texte de Bergounioux reste sans doute l’attention qu’il porte aux « petites » scènes, telle la première, où les gars en permission, avant de repartir servir de chair à canon, viennent saluer la « petite communauté », avec cette mention essentielle : « à la façon des gens qui passent présenter leurs condoléances ».
 Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, par Yves Stalloni.
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, par Yves Stalloni.
Après avoir ouvert Au revoir là-haut, impossible de le quitter. Les commentateurs ont parlé, avec parfois un peu de condescendance, de « roman populaire ». Soit. Mais l’étiquette importe peu quand il s’agit du plaisir de la lecture. Lemaitre, le bien nommé, sait raconter une histoire en ménageant les effets de surprise ou les rebondissements ; il sait créer des personnages vivants, crédibles, attachants ou répugnants.
Il sait aussi – ses précédents livres l’ont montré – utiliser les ressources des genres éprouvés : le roman noir, le feuilleton, le roman de guerre, la chronique sociale. Il reconnaît lui-même, en appendice, sa dette envers Genevoix et Barbusse, Jules Romains et Gabriel Chevallier, Dorgelès et Gaboriau, et avoue, malicieusement, de nombreuses insertions intertextuelles, parfois visibles, d’autres fois bien cachées. Mais, au total, sans pasticher ses modèles, il invente un style, une tonalité, une manière.
 Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, bientôt adapté en bande dessinée par Christian De Metter aux éditions Rue de Sèvres.
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, bientôt adapté en bande dessinée par Christian De Metter aux éditions Rue de Sèvres.
Le roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, sera adapté en bande dessinée par Christian De Metter pour les éditions Rue de Sèvres en 2015.
Au revoir là-haut est le roman de l’après guerre de 1914, de l’illusion de l’armistice, de l’État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants, de l’abomination érigée en vertu.
« Pour un romancier, voir ses personnages devenir des héros de bande dessinée est un vrai bonheur. La BD sera fidèle au livre et à l’histoire, mais la narration sera nécessairement resserrée. Ce travail très particulier m’intéresse beaucoup », a déclaré Pierre Lemaitre.
 Le Cavalier démonté, de Gisèle Bienne, par Jean-Pierre Tusseau.
Le Cavalier démonté, de Gisèle Bienne, par Jean-Pierre Tusseau.
Alors que nombre d’ouvrages évoquent directement la guerre dans son déroulement, le front, les dégâts immédiats, Le Cavalier démonté adopte un tout autre point de vue, celui des blessures que la guerre, une fois terminée, continue de causer dans l’esprit d’un homme revenu valide du front, incapable de retrouver une vie « normale » et de reprendre sa place dans le monde qui l’entoure.
Ce livre peut à lui seul faire l’objet de toute une séquence mais la vivacité et la limpidité du style permettent de le proposer aussi en lecture cursive, d’autant plus facilement que le point de vue adopté, celui d’une jeune fille qui aura « bientôt seize » ans, élève de seconde, permet au jeune lecteur une part d’identification avec la narratrice.
• Présentation du livre.
 No pasarán, de Christian Lehmann.
No pasarán, de Christian Lehmann.
Si elle s’inscrit dans le genre fantastique, la trilogie de Christian Lehmann, No pasarán, le jeu, Andreas, le retour et No pasarán, endgame, rééditée en deux volumes grand format à l’école des loisirs – mais aussi adaptée en bande dessinée par les éditions Rue de Sèvres –, offre également des résonances historiques, politiques et sociales qui présentent des liens étroits avec l’actualité européenne la plus récente.
Littéralement happés par un jeu vidéo, les trois adolescents héros du cycle romanesque sont plongés dans les conflits qui ont marqué le XXe siècle et se retrouvent involontairement impliqués sur les champs de bataille de 1914-1918, adversaires dans la guerre civile espagnole, résistants ou collaborateurs durant la Seconde Guerre mondiale.
• Présentation de la trilogie.
 Paris, 14-18. Photographies de Charles Lansiaux, par Olivier Bailly.
Paris, 14-18. Photographies de Charles Lansiaux, par Olivier Bailly.
En 1914, la Bibliothèque historique de la ville de Paris (BHVP) commande au photographe Charles Lansiaux un reportage sur la vie quotidienne des Parisiens pendant le premier conflit mondial. Une tâche dont il s’acquittera jusqu’en 1918 en réalisant un millier de photos dont environ deux cents sont exposées au milieu d’affiches originales jusqu’au 15 juin 2014 à la Galerie des bibliothèques de la ville de Paris.
L’ensemble, provenant du fonds de la BHVP, est présenté au public pour la première fois. Il demeure un témoignage essentiel sur la guerre vue de l’arrière.
.
 Été 1914. Les derniers jours de l’ancien monde, par Olivier Bailly.
Été 1914. Les derniers jours de l’ancien monde, par Olivier Bailly.
Le 28 juin 1914, François-Ferdinand, archiduc héritier du trône d’Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe de Bosnie. Tous les élèves connaissent cette date qui marque le début du premier grand conflit mondial. Le début ? Pourtant, la guerre n’a été déclenchée que le 4 août, plus d’un mois après l’attentat.
Que s’est-il donc passé entre le 28 juin et le 4 août 1914 ? C’est l’objet de la passionnante exposition intitulée Été 1914. Les derniers jours de l’ancien monde.
Coproduite par le ministère de la Défense et la BNF, elle retrace, comme l’indique sa présentation, « la succession des faits qui, petit à petit, entraîne les États européens vers le point de non-retour ».
L’exposition virtuelle proposée par la BNF.
.
 De cases en tranchées, la Grande Guerre en BD, par Youmna Tohmé.
De cases en tranchées, la Grande Guerre en BD, par Youmna Tohmé.
De Jacques Tardi à Régis Hautière, en passant par Patrick Cothias, David B, Kris et Zidrou, de très nombreux auteurs de bande dessinée choisissent d’enraciner leurs récits dans la terre riche et complexe de la Première Guerre mondiale.
On trouve ainsi des fictions prenant la guerre pour argument ou pour arrière-plan, des enquêtes policières, des histoires d’espionnage, des mélodrames, des sagas familiales, des aventures comiques, mais aussi des témoignages réels mis en images ou des récits historiques fondés sur une documentation rigoureuses.
La Grande Guerre fait l’objet de multiples déclinaisons et semble être une source d’inspiration inépuisable.
• Voir sur ce site la présentation de l’exposition De cases en tranchées conçue par l’association Bulle en tête.
 Jacques Tardi se souvient des soldats oubliés
Jacques Tardi se souvient des soldats oubliés
Sous le crayon de Jacques Tardi les poilus de 14-18 revivent.
Tous ces soldats inconnus, tous ces anti-héros ont droit à la reconnaissance. Et ceci grâce à un personnage imaginé par le dessinateur, un homme ordinaire perdu dans la tourmente.
Jusqu’au 28 juin 2014 l’espace Niemeyer rend hommage à ces sacrifiés en exposant l’intégralité des planches de Putain de guerre !, album que Jacques Tardi, l’un des maîtres incontestés de la bande dessinée moderne a composé en collaboration avec l’historien Jean-Pierre Verney.
• Voir sur notre site le compte rendu d’Olivier Bailly
.
.
Commander en ligne le numéro
de l’École des lettres, » 14-18. Écrire la guerre »(96 p., 8 € franco de port).
• Commander ce numéro par courrier :
L’École des lettres, 11, rue de Sèvres, 75006 Paris.
• S’abonner instantanément en ligne
pour avoir accès aux Archives de « l’École des lettres »
et recevoir cinq numéros (36 €)

.
La littérature et la guerre
.
Les Archives de l’École des lettres offrent un très grand nombre d’articles consacrés à la Première Guerre mondiale. Voici une sélection de ceux-ci. Ils sont instantanément téléchargeable après abonnement en ligne (accès aux Archives et réception de cinq numéros papier : 36 €).
.
 Guerre et littérature, du Moyen Âge au XXe siècle, par Pierre Moinot, de l’Académie française.
Guerre et littérature, du Moyen Âge au XXe siècle, par Pierre Moinot, de l’Académie française.
Les livres de guerre sont des livres tout court. La « transformation en conscience » de l’expérience sur laquelle ils se fondent traduit à la fois le caractère singulier des événements qui les inspirent et l’un des caractères permanents de l’espèce.
Guerre et littérature évoluent ainsi de concert, à l’image de leur époque : la nature du combat et de ses moyens, et plus encore l’esprit de la société dans laquelle il est mené, imposent au récit qui les relate sa forme propre. L’expression littéraire de la guerre suit pas à pas le cheminement de l’histoire des hommes
.
 Prix littéraires et récits de guerre. Du Feu de Barbusse aux Croix de bois, de Dorgelès, par Sylvie Ducas-Spaës.
Prix littéraires et récits de guerre. Du Feu de Barbusse aux Croix de bois, de Dorgelès, par Sylvie Ducas-Spaës.
La littérature trouve dans la guerre une occasion unique de se faire mémoire vivante d’une Histoire douloureuse, témoignage de l’horreur et de la souffrance. Asservie au devoir de « faire vrai », elle représente un cas limite du romanesque fondé sur le vécu et l’expérience, sacrifiant l’imaginaire au nom d’un souci d’exactitude érigé en principe d’écriture.
Poser la question de la lisibilité de la littérature de guerre en 1916 (Le Feu) ou en 1919 (Les Croix de bois) revient à s’interroger sur ce que veut lire, sur ce que peut lire le public d’alors.
 Le Diable au corps a-t-il réellement suscité un scandale ?, par Anne-Marie Duranton-Crabol.
Le Diable au corps a-t-il réellement suscité un scandale ?, par Anne-Marie Duranton-Crabol.
« Et dire que pour certaines gens la guerre fut le paradis ! Certaines femmes et certains collégiens… Les pères partis au front, ils eurent, les potaches comme les éventées, de belles vacances de quatre ans... »
.
 La fouille des champs d’honneur : L’Acacia, de Claude Simon, Les Champs d’honneur, de Jean Rouaud, Un long dimanche de fiançailles, de Sébastien Japrisot, par Jacques Le Marinel.
La fouille des champs d’honneur : L’Acacia, de Claude Simon, Les Champs d’honneur, de Jean Rouaud, Un long dimanche de fiançailles, de Sébastien Japrisot, par Jacques Le Marinel.
Ces trois romans confrontent la violence de l’Histoire et l’intériorité de ceux qui survivent, grâce à leur mémoire affective, à la force de l’amour. La fouille des champs d’honneur est aussi celle de la mémoire, aidée par certains moyens qui la revivifient en fixant le souvenir.
 Les Champs d’honneur, de Jean Rouaud, par Sylvie Ducas-Spaës.
Les Champs d’honneur, de Jean Rouaud, par Sylvie Ducas-Spaës.
» La guerre de 14, c’est l’événement fondateur de notre époque. Cette guerre qui a tout détruit, à commencer la mémoire. »
Ce n’est ni Barbusse, ni Dorgelès, ni Cendrars, ni Céline, qui énoncent cette vérité, mais Jean Rouaud, en 1990, tandis que son premier roman, Les Champs d’honneur, connaît un succès immédiat.
Au fil d’une narration adoptant à première vue les accents contenus de la conversation anodine, en venir à dire la guerre dans son indicible horreur, tel est le pari tenu par Jean Rouaud. Du roman familial recomposé par la mémoire intime d’un scripteur discret, des drames privés d’une famille ordinaire, le roman parvient à faire surgir la tragédie nationale de 1914-1918 en quelques pages débarrassées de tout poncif et d’un souffle épique à couper le vôtre.
 Entretien avec Jean Rouaud.
Entretien avec Jean Rouaud.
« Quand vous lisez ces livres-là – Voyage au bout de la nuit, Normance, Rigodon – vous savez que c’est possible de raconter la guerre des tranchées ou un bombardement. Cela a été fait, donc vous pouvez encore le faire, faire en sorte qu’en lisant, soudain, on reçoive tout sur la tête. Et c’est pour cela que c’est important de lire et d’écrire, pour qu’on reçoive le ciel sur la tête ! »
 Les figures littéraires du colonisé, par Sylvie Ducas-Spaës et Catherine Brun.
Les figures littéraires du colonisé, par Sylvie Ducas-Spaës et Catherine Brun.
« Morts pour la France », telle est l’inscription gravée sur tous les monuments aux morts de 1914-1918, par lesquels la « patrie reconnaissante » rend hommage à ses « enfants tombés au feu. Dans chaque ville, dans chaque village, est ainsi rappelé le souvenir des combattants français natifs du lieu. Mais qu’en est-il des Français des colonies venus défendre la métropole en danger, et dont aucun de ces monuments ne semble garder la mémoire ?
C’est la même amnésie qui semble frapper les évocations littéraires de la Grande Guerre. Ni Kessel, ni Dorgelès, ni Genevoix, ni Remarque, ni Cendrars, ni Céline, ne prennent les colonisés dans leur champ de vision…
..
 Les combattants coloniaux, par Michel Marbeau.
Les combattants coloniaux, par Michel Marbeau.
La Première Guerre mondiale est d’abord européenne : essentiellement, elle oppose des Européens, et le vieux continent sert de théâtre aux opérations. Cependant, presque toutes les nations concernées disposent d’empires coloniaux étendus, et l’entrée dans la guerre suppose la mobilisation de toutes les forces vives.
Or, pour la France notamment, ces colonies ne sont bien souvent que des taches roses sur un planisphère. On connaît mal cet empire de dix millions de kilomètres carrés qui fait de la métropole la deuxième puissance coloniale mondiale…
 Le théâtre expressionniste et la guerre, par Lionel Richard.
Le théâtre expressionniste et la guerre, par Lionel Richard.
La génération des écrivains nés autour de 1890, et qu’il est convenu d’appeller, en raison de leur opposition au naturalisme et à l’impressionnisme, des « expressionnistes », a été frappée de plein fouet par le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
La classe des expressionnistes les vouait nécessairement à partir au front. En août 1914, ces jeunes Allemands et Autrichiens sont presque tous partis se battre la fleur au fusil. Pris dans la frénésie patriotique et les brumes de la propagande impériale, ils se portaient volontaires pour défendre la « civilisation germanique ». Les pacifistes étaient isolés comme des brebis galeuses. Leur petit nombre les condamnait à l’inefficacité.
 Capitaine Conan, de Roger Vercel, La Comédie de Charleroi, de Pierre Drieu la Rochelle : mythe et réalité du héros de guerre, par Jacques Le Marinel.
Capitaine Conan, de Roger Vercel, La Comédie de Charleroi, de Pierre Drieu la Rochelle : mythe et réalité du héros de guerre, par Jacques Le Marinel.
Le type du héros guerrier dans la littérature tend à se confondre avec le genre de l’épopée, qui a permis de définir la structure du « modèle héroïque ». La guerre moderne est-elle toujours « accoucheuse de héros », les récits qui ont pris pour sujet celle de 1914-1918, en particulier, réussissent-ils à construire et à fixer un nouvel avatar du mythe ? Afin de répondre à cette question, nous nous proposons de rapprocher deux œuvres en apparence très différentes, si l’on excepte la date commune de leur parution : il s’agit d’une part du roman de Roger Vercel, Capitaine Conan, qui obtint le prix Goncourt en 1934, et d’autre part du recueil de nouvelles composé par Drieu la Rochelle et qui porte le titre de la première d’entre elles, La Comédie de Charleroi.
La validité de ce rapprochement apparaîtra à condition de définir rigoureusement le projet, et d’abord de marquer les limites du sujet. Notre ambition n’est pas de chercher à voir en quoi s’amorce dans La Comédie de Charleroi la conversion idéologique de son auteur. La problématique restera celle du héros, sa construction et sa déconstruction, dans l’action qui occupe la plus grande partie du roman de Roger Vercel, comme dans la réflexion que mène Drieu tout en revivant ses souvenirs de la guerre dans les récits rétrospectifs à caractère autobiographique du recueil.
.
 À l’Ouest, rien de nouveau, d’Erich Maria Remarque, par Marlis Hagen.
À l’Ouest, rien de nouveau, d’Erich Maria Remarque, par Marlis Hagen.
Aucun livre écrit sous la république de Weimar n’a suscité autant de débats et de discussions qu’À l’Ouest, rien de nouveau, d’Erich Maria Remarque. Cet ouvrage n’était pourtant pas le premier à parler de la guerre, mais il suivait une certaine tradition littéraire qui se divisait en deux courants. D’une part, le courant antimilitariste, où se sont illustrés Barbusse, avec Le Feu, Dos Passos, avec Three Soldiers, et, en Allemagne même, Arnold Zweig, avec Streit um den Sergeanten Grischa, ou bien Ludwig Renn, avec La Guerre. D’autre part, certains auteurs virent dans la guerre l’occasion d’une mise à l’épreuve et d’un épanouissement de la virilité ou d’une libération des liens moraux et des entraves idéologiques de l’ordre bourgeois, comme Ernst Jünger avec Orages d’acier (In Stahlgewittern).
Or aucun de ces ouvrages ne suscita autant de controverses dans la critique et de réactions subjectives qu’À l’Ouest, rien de nouveau. Remarque avait touché un point sensible de son époque. Les partisans de son roman y voyaient enfin une description vraie et authentique, et saluaient l’appel à un nouvel humanisme comme un héritage précieux pour les futures générations. Ses adversaires, au contraire, le considéraient comme dangereux et nuisible à la morale des jeunes, son message s’opposant à leurs projets politiques. Ainsi la première projection du film adapté du roman en 1930 fut-elle interrompue par des groupes nazis, et le livre fit-il partie des ouvrages brûlés lors de l’autodafé de 1933.
.
 Roger Martin du Gard, par André Alessandri et Jean-François Massol.
Roger Martin du Gard, par André Alessandri et Jean-François Massol.
La littérature de l’entre-deux-guerres se trouve inondée de souvenirs écrits par les « témoins » mêmes de la guerre. Quand on replace le cas de Roger Martin du Gard dans cet ensemble foisonnant, on ne peut qu’être frappé des particularités de cet écrivain. S’il y a bien, de lui, un témoignage sur la Première Guerre mondiale, il ne sera pas immédiatement livré au public par son auteur, mais il faudra attendre la publication des correspondances et la parution du Journal pour lire, sur cette Grande Guerre, un ensemble de notes, de remarques, qui développent finalement un sentiment très personnel.
C’est aussi que sa qualité de témoin rend un son très particulier. Enfin, publiés respectivement en 1936 et en 1940, les deux romans qui couronnent Les Thibault sont bien issus de l’expérience vécue de la guerre, mais ils ne sont rien moins que des romans du témoignage.
.
 L’Initiation d’un homme, de John Dos Passos, par Jacques Le Marinel.
L’Initiation d’un homme, de John Dos Passos, par Jacques Le Marinel.
L’entrée en guerre des États-Unis en 1917 a donné naissance à une série de points de vue, de la part de ceux qui, comme John Dos Passos, ont été amenés à affronter une réalité jusque-là lointaine. L’intérêt particulier de L’Initiation d’un homme vient du fait que ce premier roman est la transposition de l’expérience traumatisante que fit son auteur, à l’âge de vingt et un ans, de l’enfer de la Grande Guerre.
Rapportant beaucoup plus tard les circonstances dans lesquelles il rédigea ce récit, il écrit, dans la Belle Vie : « Pendant la traversée de retour sur l’Espagne, en février, j’avais lu Le Feu de Barbusse. J’avais été bouleversé par ce livre, mais je connaissais déjà assez bien la guerre en France pour découvrir d’autres aspects de la question. La guerre était le thème de l’époque. Je brûlais de mettre sur le papier tout ce que j’avais vu, tel quel et sans autre forme de procès. » Mais la spontanéité et l’art un peu cru de l’écrivain débutant n’empêchent pas la profondeur de la leçon qui se dégage de ce livre.
..
 L’Adieu aux armes, d’Ernest Hemingway, par Yves Stalloni.
L’Adieu aux armes, d’Ernest Hemingway, par Yves Stalloni.
Au moment de la publication de L’Adieu aux armes, en 1929, un journaliste du New York Herald Tribune, Edward Hope, déclarait de façon lapidaire : « L’Adieu aux armes est une chose dont on n’a pas envie de parler. »
On pourrait dire avec quelque cynisme que le gouvernement de Mussolini a scrupuleusement suivi ce conseil en interdisant immédiatement le livre et le film que Frank Borzage en avait tiré en 1932, avec Gary Cooper dans le rôle de Frederic Henry, jugeant qu’ils « présentaient sous un jour trop défavorable les vertus guerrières du peuple italien ». Le régime fasciste ne faisait alors que suivre l’exemple donné par le chef de la police de Boston qui décida de refuser pour sa ville la sortie des numéros de juin et juillet du Scribner’s Magazine où était publié pour la première fois en feuilleton le roman d’Hemingway. Il est vrai que, dans ce dernier cas, la cause de la censure était moins politique que morale. L’immense et immédiat succès de ce livre, en dépit des mises en garde et des interdits, a prouvé que le grand public ne partageait pas les réserves douteuses dont il était l’objet et estimait qu’il méritait une large audience.
.
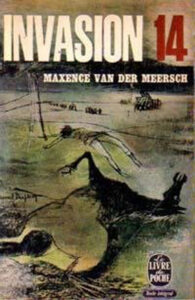 Invasion 14, de Maxence Van der Meersch, par Paul Renard.
Invasion 14, de Maxence Van der Meersch, par Paul Renard.
Van der Meersch, quand il publia Invasion 14 en 1935, n’était pas un inconnu. Il avait fait paraître La Maison dans la dune en 1932, roman popularisé en 1934 par le film qu’en tira Pierre Billon, Car ils ne savent pas ce qu’ils font (1933), récit à base autobiographique, et Quand les sirènes se taisent (1933), relation d’une grève dans le textile roubaisien.
À partir de ce dernier roman, Van der Meersch se voulut peintre réaliste du peuple ; après avoir rivalisé avec Germinal, de Zola (un de ses modèles), il marcha à nouveau sur les traces de celui-ci : Invasion 14 est sa Débâcle. Invasion 14 est une somme romanesque, par son ampleur (360 pages) et par la recherche d’exhaustivité temporelle, spatiale et sociale. Le titre du roman ne prend pas un sens restrictif. Van der Meersch ne raconte pas seulement les débuts de la guerre, mais presque toute la durée du conflit, principalement dans le triangle formé par Roubaix, Tourcoing et Lille.
 Le Grand Troupeau, de Jean Giono et Le Sang noir, de Louis Guilloux, deux représentations de l’« arrière », par Jacques Le Marinel.
Le Grand Troupeau, de Jean Giono et Le Sang noir, de Louis Guilloux, deux représentations de l’« arrière », par Jacques Le Marinel.
La littérature issue de la Première Guerre mondiale comprend des oeuvres diverses dont les plus connues sont certainement celles qui décrivent les horreurs du front. Nous avons choisi une autre perspective en adoptant le point de vue de l’« arrière », à travers deux romans, Le Grand Troupeau, de Jean Giono, et Le Sang noir, de Louis Guilloux, parus respectivement en 1931 et en 19351.
Un critique situe en ces termes le roman de Giono dans son œuvre : « Il reste que 1931 marque une date, car Le Grand Troupeau confronte pour la première fois le monde de la nature et le monde de la civilisation industrielle oppressive représentée sous sa forme apocalyptique, la guerre. » Celle de 1914 est un événement qui aura marqué profondément les deux auteurs, bien que Louis Guilloux, plus jeune de quelques années, n’ait pas participé directement à la guerre. Mais s’il s’intéresse à ses répercussions à l’arrière en 1917, dans une ville de province qu’il connaît bien, c’est qu’« à ce moment-là, la France est livrée à l’inauthentique ».
.
 Le Sang noir, de Louis Guilloux, par Pierre-Yves Bourdil.
Le Sang noir, de Louis Guilloux, par Pierre-Yves Bourdil.
Le Sang noir appartient à cette race de livres qui interdisent qu’on les lise innocemment. Ils nous compromettent par leur vitalité quasi autonome, à l’instar des écrits dont Socrate peint dans le Phèdre la « terrible » activité. Équivoques de nature, ils obtiennent de nous que nous les prenions au mot, fût-ce à notre corps défendant, jusqu’à ce que nous investissions le caractère impudique de leur sens.
Le Sang noir plaide la cause de son héros principal, Cripure, lequel est philosophe. Cela suffit pour tout changer : telle est la thèse. Nous devons écarter l’argument selon lequel la fonction du philosophe serait de même nature que celle d’un marchand de draps, d’un pharmacien ou d’un prêtre, par exemple. Socialement, peut-être, mais la question n’est pas là. Cripure n’est pas un personnage qui serait qualifié par son métier de philosophe. Son métier, s’il en a un, c’est d’enseigner dans un lycée.
.
 Lettres et carnets du front, par Michel Marbeau.
Lettres et carnets du front, par Michel Marbeau.
« La France ne PEUT pas tenir encore bien longtemps » (veillée de Noël 1914 au corps de garde) ;
« Je pressens maintenant que la fin de la guerre approche à pas de géants […]. J’estime désormais probable qu’au printemps 1916 nous connaîtrons la fin – si ce n’est même un peu plus tôt. Le désarroi de l’Entente sur l’échiquier stratégique est par trop flagrant » (13 octobre 1915) ;
« Un troisième hiver de guerre ? JAMAIS ! JE N’Y CROIS PAS. Penser cela est tout simplement INORGANIQUE. Cet été sera décisif » (7 février 1916).
 Une littérature de guerre, par Jean-Louis Rambour.
Une littérature de guerre, par Jean-Louis Rambour.
S’interroger sur la littérature de cette guerre, c’est voir s’ouvrir un immense champ de lecture. En effet, un grand nombre d’œuvres anticipent le conflit, analysent aujourd’hui encore ses conséquences ou en font le support historique de drames humains.
De plus, bien des ouvrages lient inextricablement les Première et Seconde Guerres mondiales : Les Communistes, d’Aragon ; Aurélien, où le même auteur avoue avoir mis un peu du Drieu de Charleroi dans ce jeune homme, jamais vraiment remis de la Grande Guerre, et qui verra sa Bérénice mourir dans ses bras au début de la suivante ; La mort est mon métier, de Robert Merle, où l’on suit l’itinéraire d’un simple soldat allemand du premier conflit, qui deviendra plus tard le chef d’un camp de concentration. On pourrait bien sûr citer quantité d’autres exemples, qui montreraient à quel point la « littérature de guerre » forme un immense domaine, indissociable de l’histoire de la littérature française et mondiale.
Toutefois, si la guerre a créé un langage et surtout un genre littéraire, c’est le refus de cette réalité parvenue à un point d’horreur tel qu’il a banalisé toute fiction qui va être à l’origine de la littérature la plus novatrice issue de la guerre. Dans sa proclamation publiée dans le n° 14 de la revue Sic (février 1917), Pierre Albert-Birot écrit : « Perfectionner est bien ! Créer est mieux ! Pourquoi ne regardez-vous que dans la direction où regardent les autres ? Ex. : Pourquoi l’engin supérieur à un canon ne serait-il pas autre chose qu’un canon ? Cherchez autre chose, toujours autre chose, encore autre chose. »
• Voir sur le site de « l’École des lettres » : « La Grande Guerre des écrivains« , anthologie réunie par Antoine Compagnon, par Yves Stalloni.
• La Grande Guerre dans tous ses états. Ateliers d’écriture et de pratique artistique du collège au lycée, mallette pédagogique proposée par Perrine Jaquier et Gwenaël Devalière.
.
Pour télécharger instantanément
l’ensemble de ces études,
avoir accès aux Archives
de « l’École des lettres »
et recevoir cinq numéros de référence
abonnez-vous en ligne (36 €)•
Le dossier « 14-18. Écrire la guerre »
sera régulièrement enrichi de nouvelles contributions.
Pour être tenu(e) informé(e) de ces mises à jour,
inscrivez-vous sur courrier@ecoledeslettres.frde l’École des lettres, « 14-18. Écrire la guerre »
(96 p., 8 € franco de port).
• Commander ce numéro par courrier :
L’École des lettres, 11, rue de Sèvres, 75006 Paris.

