« Englebert des collines », de Jean Hatzfeld
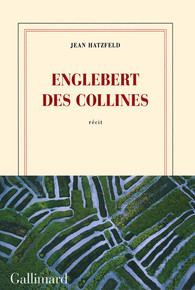 « Même les animaux sauvages
« Même les animaux sauvages
refusaient de voir ça. »
« Souvent les rêves me rappellent ma mère, mon père. » La phrase est dite par Englebert, l’homme qu’a accompagné et écouté Jean Hatzfeld à Nyamata, au Rwanda. Pourtant, à la lire, on penserait au Garçon qui voulait dormir, de Aharon Appelfeld ou à d’autres romans ou récits de rescapés de la Shoah.
Qu’elle figure dans un texte ou l’autre dit la proximité entre ces génocides, l’un conduit il y a plus de soixante dix ans, l’autre il y aura vingt ans, le 7 avril prochain.
Journaliste à Libération au moment du crime, Hatzfeld a découvert le Rwanda en août 1994. Et quelques années après, il a vécu dans le pays, dans la campagne, écoutant d’abord les survivants, puis les meurtriers, racontant les retrouvailles dans les villages.
Cette trilogie, rééditée en un volume aux Éditions du Seuil, fait partie de ces grands livres du XXe siècle qui sont autant de stèles dédiées aux morts, et autant de paroles contre l’oubli, la banalisation ou la négation.
Histoire de tueries
Englebert des collines est le résultat d’une rencontre et paie une sorte de dette. Souvent Hatzfeld a offert des verres à son interlocuteur, l’a emmené dans sa voiture jusqu’à la maison qu’il habitait. Et comme Englebert parle autant qu’il aime marcher, se promener, il a raconté sa vie. Il a désormais soixante-six ans, et est un pan de la mémoire locale : « Quand on se sent un peu accablé par l’histoire des tueries qui hantent la région, Englebert est de ceux dont on apprécie l’humeur lunatique, les colères, la roublardise, les fulgurances joyeuses ou désespérées », écrit l’auteur.
Ces fulgurances passent d’abord dans la langue de ce personnage. Une langue française comme on l’enseignait au Christ-Roi, avec Pascal, Racine, Corneille et « tous consorts », pour reprendre une expression qui lui est chère. Aussi démuni soit-il, il ne quitte pas son livre de chevet, L’Iliade. Englebert vit en effet comme une sorte de vagabond, allant et venant dans les rues de Nyamata, connaissant tous les bars et cabarets, ne délaissant aucune boisson et pas plus l’urgwagwa, que le lecteur découvrira, que la Primus, la bière nationale.
La « fatalité d’être Tutsi »
Il aurait pu faire une brillante carrière. Sa vie avait débuté sous les meilleurs auspices. Son arrière-grand père était un roi et « causait de splendide manière ». Lui-même était parti pour devenir haut-fonctionnaire. La « fatalité d’être Tutsi » l’a empêché de gravir les échelons. Numerus clausus, renvois, il a dû retourner au champ familial, à la parcelle.
Dès 1959, pogroms et massacres émaillent la vie des Tutsis. Il se trouve bien quelques « avoisinants » pour les protéger ou conserver leurs biens, mais la mécanique meurtrière est enclenchée. Elle se déchaîne donc en 1994, et on comptera 52 000 cadavres dans les rues et alentours de Nyamata.
Le récit des massacres, celui des fuites matinales et des errances quotidiennes est effrayant : « même les animaux sauvages refusaient de voir ça », dit Englebert. Quelques scènes suffisent à se figurer l’horreur des marais, la saleté, la peur. Après, ce n’est pas mieux. Englebert raconte la stupeur lorsque les assassins fuient, remplacés par les Inkotanyi, des Tutsis appartenant au FPR qui libèrent le pays. Pas de joie, à peine du soulagement.
Le temps de la culpabilité
Vient le temps de la culpabilité. Les survivants se demandent comment et surtout pourquoi ils ont été épargnés. Certains s’en remettent à dieu, comme le fait Englebert, d’autres à la chance.
Mais cela ne suffit pas. Englebert et les autres sont détruits : « mon esprit se désordonnait », explique-t-il, évoquant ses errances dans des rues vides ou dépeuplées, avec l’alcool pour vague consolation.
« Il parlait et il buvait », dit de lui Marie-Louise que rencontre Hatzfeld. Et lui ajoute combien sa parole était devenue libre, ne voyant plus de hiérarchie entre un maire et un vagabond, conversant avec un monsieur coréen et riant avec lui, dans une langue impossible à identifier : « J’aime jongler de bons mots avec les gens », dit-il.
« Ma mémoire ne trie rien »
Le génocide est présent, dans ses cauchemars ; Englebert ne retourne pas dans les marais qui l’ont protégé. Ses frères et sa sœur n’ont pas de sépulture. Il n’a rien oublié : « Est-ce que ma mémoire trie les souvenirs ? Comment trier ? Ma mémoire ne trie rien sans que je ne lui demande et je ne lui demande rien. » Sa vie a été détruite par le génocide. Il est seul sans sa famille, ne se sent « pas à l’aise avec cette existence ».
Il n’en a pas moins des projets pour l’avenir, rêve de se marier, d’avoir deux ou trois enfants, de s’établir sur une parcelle avec sa femme. C’est écrit au futur.
À lire ce récit, on croit entendre ou voir les survivants que Lanzmann interrogeait dans Shoah, ces hommes qui continuaient à chanter, à sourire, à vivre et à parler avec, tout au fond d’eux, la cicatrice profonde d’une blessure qui ne peut se refermer.
Norbert Czarny
.
• Jean Hatzfeld, t « Englebert des collines », Gallimard, 2014, 112 p.
• Voir sur ce site :
« Robert Mitchum ne revient pas », de Jean Hatzfeld, par Norbert Czarny,
« Le garçon qui voulait dormir », d’Aharon Appelfeld, par Norbert Czarny,
« L’Élimination, de Rithy Panh », par Yves Stalloni.
et dans les archives de « l’École des lettres », les études consacrées à Primo Levi.
.
